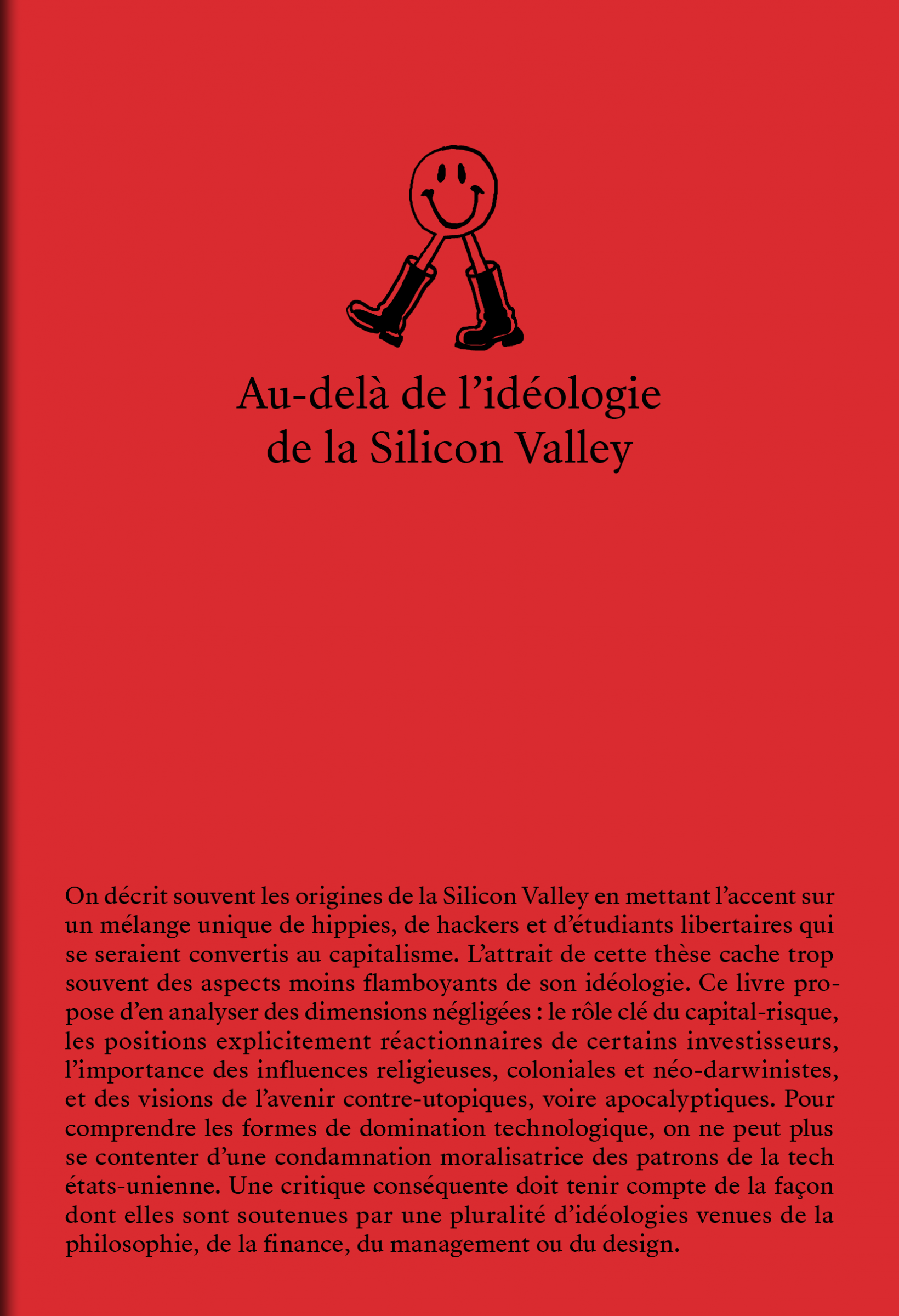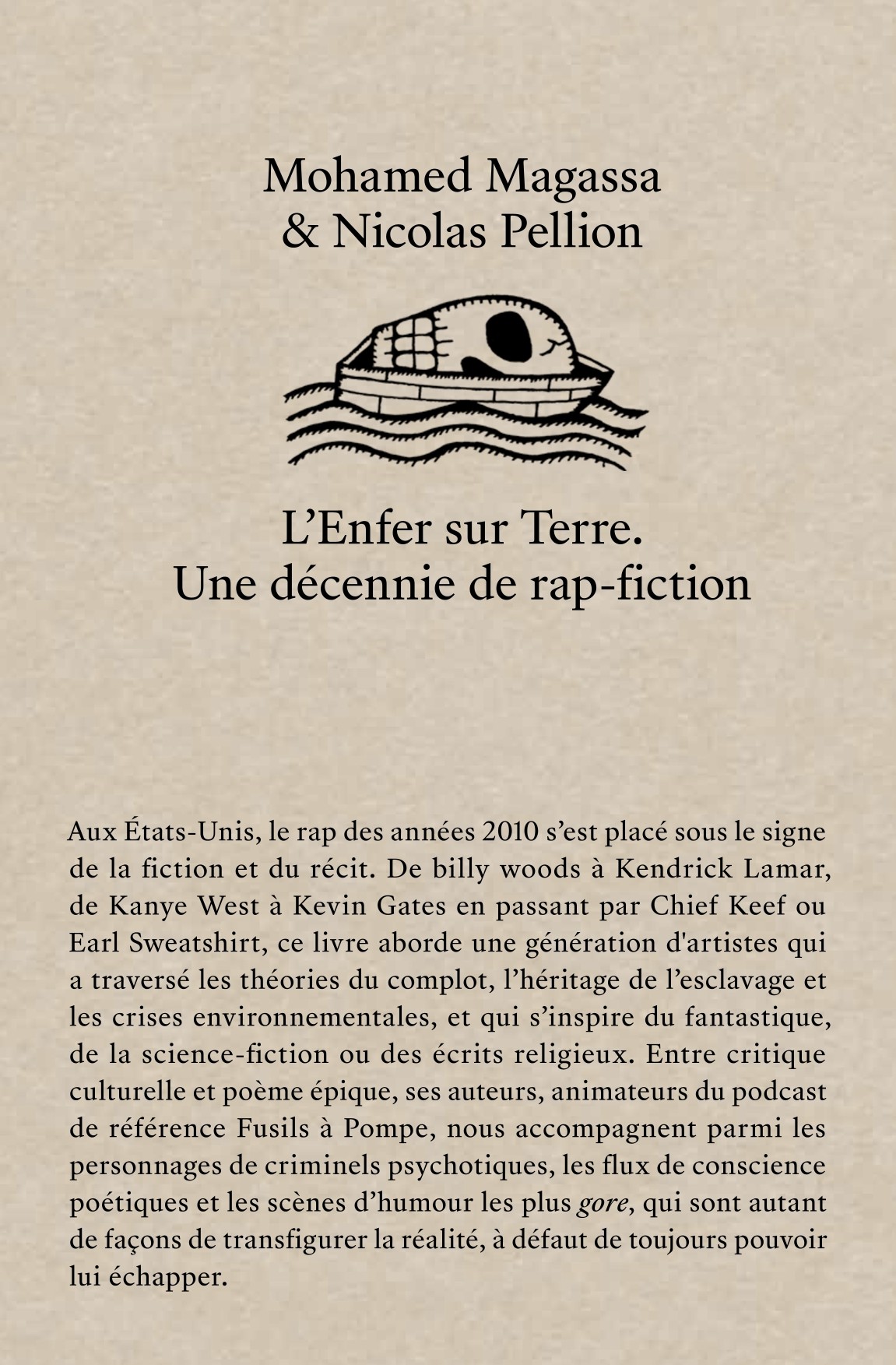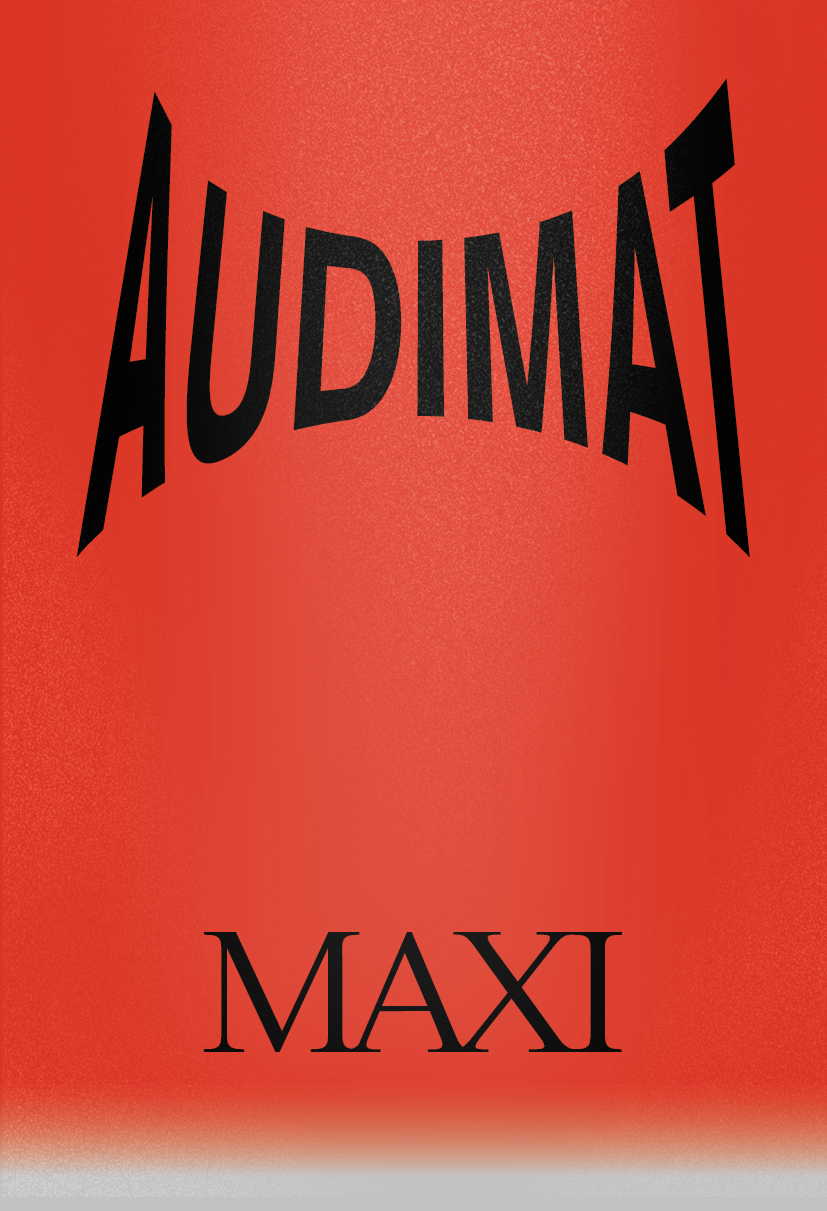Chanson, folklore et sentiment : aux sources du répertoire de Céline Dion
Carl Wilson
Let’s Talk About Love – A Journey to the End of Taste du Canadien Carl Wilson, aujourd’hui journaliste à Slate, est paru en 2007 chez Bloomsbury. Très bel exemple de la façon dont l’analyse de la pop peut nourrir une réflexion plus générale sur la culture, Let’s Talk About Love est avant tout un livre sur Céline Dion. Pour essayer de percer le mystère du consensus critique contre la star québécoise — et comprendre sa propre aversion pour ses chansons — Carl Wilson y multiplie les angles d’approche. Convoquant aussi bien la sociologie (le capital culturel bourdieusien) que l’intime, la démographie que l’expérience de terrain (Céline à Las Vegas), l’éthique que l’esthétique, il interroge les notions de cool et de bon goût. Après avoir relié Céline Dion à l’affirmation d’une identité québécoise minoritaire dans un contexte anglo-saxon, Wilson fait un pas de côté pour s’intéresser aux origines américaines de ce qui sonne chez elle si « sentimental ». Partant d’une polémique qui lui permet de singulariser Céline Dion face au lot des divas R&B, il met à jour les racines du « schmaltz » : un courant souterrain et vibrant, à peine un genre musical. Une quête d’autant plus captivante que Wilson s’y livre finalement à une tentative d’isoler ce composant, essentiel mais volatil, qui fait qu’une pop song réussie ne laissera personne indifférent.
De la techno autarcique
Étienne Menu
La dance music en général, la techno en particulier, s’est construite sur ses rapports au dancefloor. Dans la production, dans l’écoute, dans les commentaires, il s’agit toujours de dire l’efficacité de cette musique, si ça fonctionne, comment ça fonctionne (où, sur qui, pourquoi), ou à l’inverse de justifier le paradoxe que constitue l’écoute attentive, appréciative, esthète d’une musique censée se dissoudre dans le mix et dans ses effets. Ainsi à un magasin en ligne comme Beatport qui ramène cette musique à une description fonctionnaliste par genres, par BPM, par forme d’onde, répond la valorisation critique d’une techno « libre ». Mais entre ces deux pôles presque trop évidents, tout un monde d’ambiguïtés persiste. Avec ce texte, Étienne Menu, co-rédacteur en chef d’Audimat, met au jour une ligne invisible, qui va de Rhythim Is Rhythim à Cristian Vogel, et qui correspond à ses émotions d’auditeur face à ce qu’il propose de définir comme une « techno autarcique ».
Parler de l’existence d’une catégorie esthétique jusqu’ici non identifiée, propre à une musique produite de façon commerciale, industrielle et rarement alimentée par un discours étayé, revient finalement à parler d’une existence fictive ou science-fictive, à enregistrer la teneur de quelques fantasmes. Ni théorie rigoureuse, ni pure subjectivité, il s’agit d’abord d’une collection de sensations, de souvenirs et d’images – mais aussi d’une redéfinition utopique de ce que la techno peut offrir de meilleur.
Sur "Love Child" des Supremes
Michelangelo Matos
Il était une fois, au début des années 1960 à Detroit, Michigan, un trio de chanteuses qui allait devenir célèbre grâce à des tubes comme « Baby Love » ou « Where did our love go » et servir de tremplin à la diva Diana Ross : les Supremes. L’histoire du groupe ne se résume toutefois pas à un simple chapitre de la légende de la soul. Ni même à la façon dont Motown, sa maison-mère, a su faire de l’art et de l’argent. Dans ce texte, le journaliste américain Michelangelo Matos (passé par le Guardian, Village Voice ou encore Rolling Stone) a choisi d’en faire la démonstration en se penchant sur le berceau de « Love Child ». En déconstruisant ce succès tardif et emblématique des Supremes, il va mettre en lumière un pan entier de l’histoire sociale des États-Unis et, en lui superposant son propre roman familial, comprendre ce que tout amateur de pop pressent de manière plus ou moins diffuse : une simple chanson peut devenir une véritable question de vie ou de mort.
Original Body Contour : Notes nouvelles sur Robert Quine, mercenaire intègre du rock
Louis Picard
Quel est le point commun entre Richard Hell, John Zorn, Lou Reed et Brian Eno ? Tous ont fait appel aux « guitaroïdes » services de Robert Quine, musicien admirable mais méconnu — s’inscrivant ainsi dans la cohorte des musiciens de studio à l’apport décisif et secret — quand il n’est pas mal aimé, faute de rentrer dans les cases du bon goût rock. Si bien que ce texte de Louis Picard est moins une discographie sélective ou un exercice de réhabilitation qu’une méditation sur l’éthique du jeu de guitare et les faces B de l’histoire.
L’héritage aztèque via FruityLoops : le paradis adolescent du Tribal Guacharero
Jace Clayton
Alors que les grandes catégories comme « world music » ou « indie rock » apparaissent plus fragiles que jamais, et que les rythmes issus des ghettos mondiaux sont sans cesse hybridés aux formes les plus mainstream de dance music, on finirait presque par oublier que les scènes locales n’ont pas disparu. Même si les fichiers s’échangent à haute fréquence entre les continents, certains styles continuent de trouver leur sens dans des contextes très spécifiques. C’est le cas du Tribal Guarachero, une dance music syncrétique d’origine mexicaine, dont les ados de la ville de Monterrey, au nord du pays, ont fait un sacerdoce. Dans cet article publié en 2010 par The Fader, Jace Clayton, aussi connu sous le nom de DJ/rupture, s’intéresse au son et à la vie de ces superstars de quartier.
Pop Montréal, le festival quotidien
Julien Besse
Julien Besse est né en 1980 à Lyon. Venu à l’écriture par la bande, celle de son goût pour les scènes punk et hardcore, il a organisé des concerts, créé des fanzines (Heartbeat, Freak Out! ou Inégale), publié des nouvelles et travaille actuellement à l’écriture de son premier roman. À Montréal, où il a séjourné longuement, il a fait le constat d’une vie urbaine en voie de « festivalisation » galopante. Festivals et évènements culturels s’y succèdent ainsi sans fin. Jusqu’à la perte d’identité ? Peut-être… En partant du cas exemplaire du festival indie Pop Montréal, créé en 2002, il se pose dans cet article une question qui nous intéresse à plus d’un titre : celle de la troublante familiarité de ce qui prétend pourtant faire événement.
Une histoire orale du boogie français
Rod Glacial
La France pré-French Touch n’en finit plus de livrer ses secrets les plus inavouables. Si l’épopée des jeunes gens modernes, pop et synthétique est désormais bien documentée, une autre histoire reste discrète : celle du funk hexagonal. Une hypothèse musicale qu’ont vécu aux premières loges des personnalités comme Sidney, Phil Barney, Micky Milan, Agathe ou Dee Nasty. Rod Glacial, rédacteur en chef adjoint chez Noisey et passionné de l’esthétique 80s (à travers son blog Fluo Glacial et le duo de DJ France80), a choisi de faire parler les acteurs de cette scène, liée aux premières radios libres et à une poignée de clubs devenus « mythiques » – au moins dans l’esprit de ceux qui en ont arpenté les pistes d’Alain Maneval, à Clémentine Célarié, en passant par le Rock Steady Crew ou François Feldman. Aujourd’hui, le gloss des synthétiseurs cède à une part d’amertume…