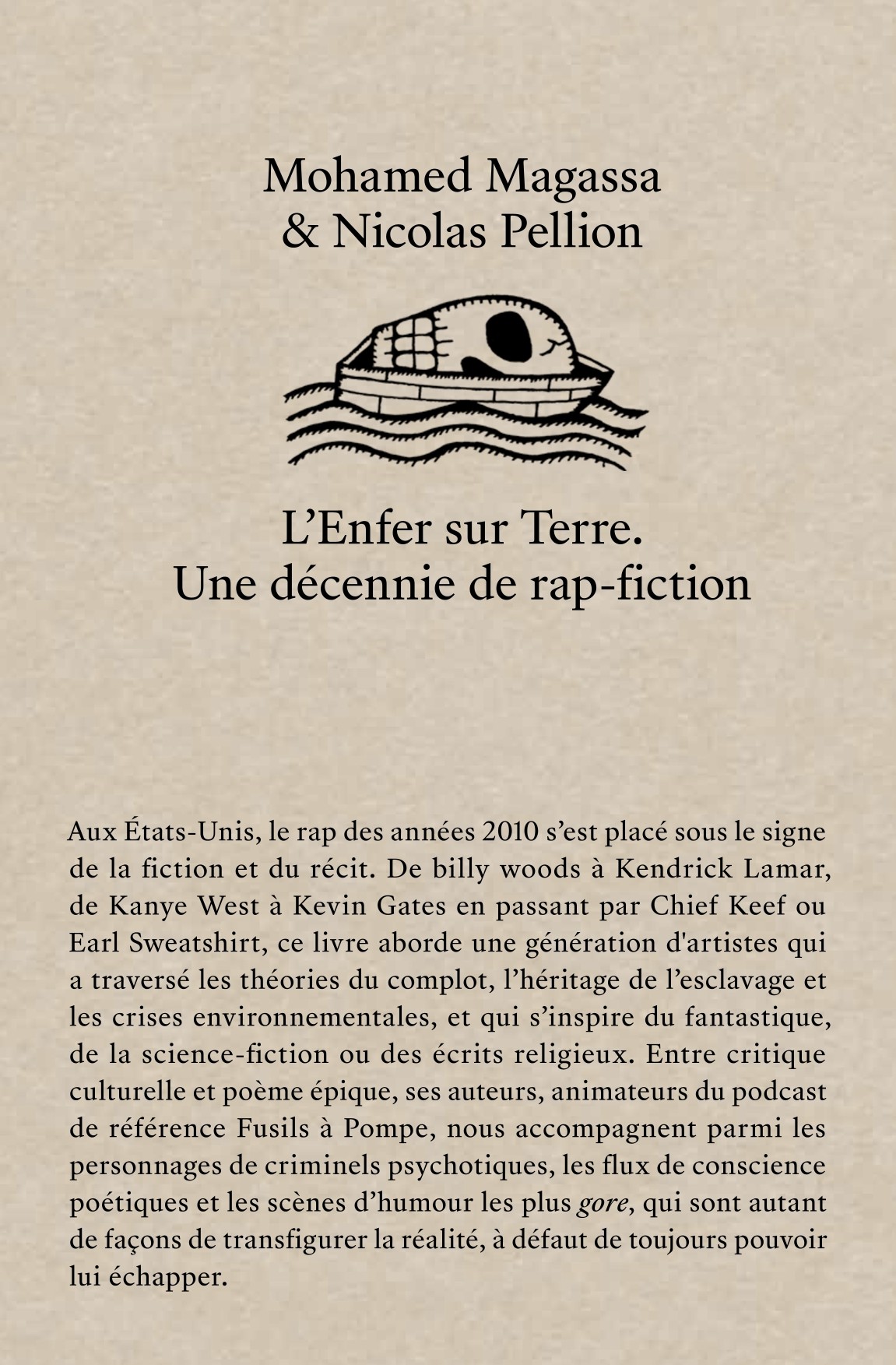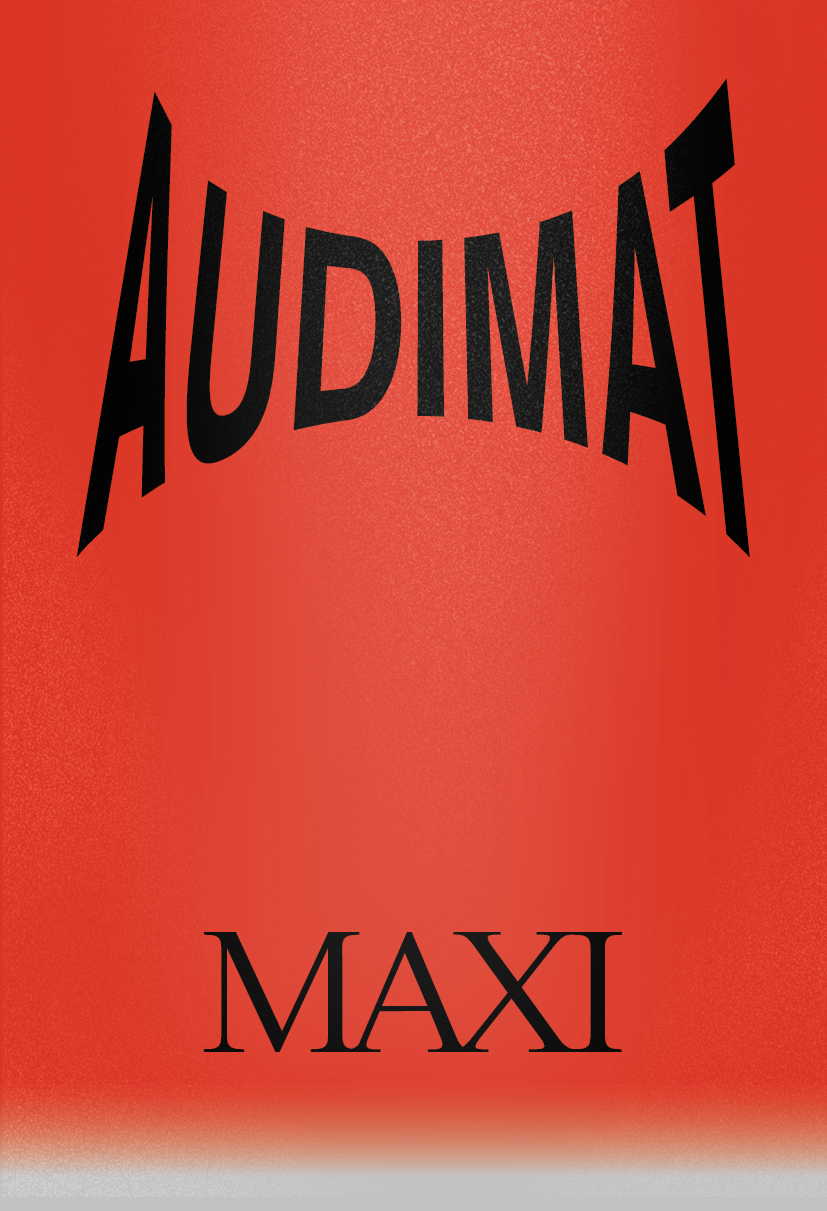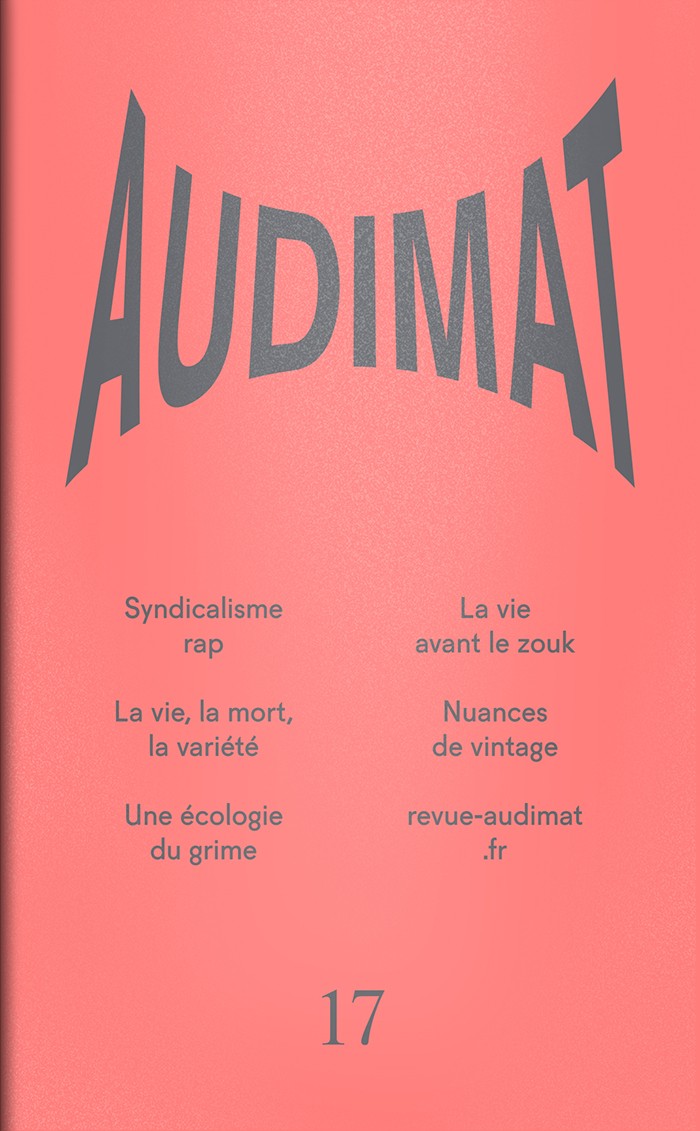Audimat 18
Audimat 18
https://audimat-editions.fr/media/pages/catalogue/audimat-18/c7dd7411a7-1664523616/audimat18-cover.png
10
audimat-18
0
PDF
6 €
Acheter
Faire grimacer la pop
Jouir dans les aigus
J Dilla, presque à temps
L’ennui avec les musiques improvisées
Penser hardcore
Faire grimacer la pop
Dans le sillon de sa réflexion sur ce que la fréquentation assidue des internets provoque chez certain·es musicien·nes d’aujourd’hui, la critique d’art et contributrice à Musique Journal Julie Ackermann tente ici de débrouiller les liens entre le capitalisme numérique et les dernières mutations de la pop. L’hyperpop, cette « pop extrême pour des temps extrêmes », y est abordée au travers des démêlés de celles et ceux qui s’y rattachent — principalement autour de sa première vague incarnée par PC Music — avec une époque morbide, faite de numérisation, de commodification, ou encore de déréalisation, soit autant de gros mots et de conséquences bien réelles avec lesquels nombre de musicien·nes d’aujourd’hui doivent composer. Si nos goûts musicaux sont indissociables du capitalisme, que faire ? Acheter une guitare pour jouer sur la place du village ? Ou embrasser la musique de son temps, la « condition digitale » et ses codes pour en montrer la monstruosité, et transformer ce qui nous plombe en diamants ? C’est à cette seconde option que s’intéresse Ackermann. En témoignant de sa propre fascination pour l’hyperpop et en collant au plus près de son univers, elle nous propose d’embrasser ses grimaces radieuses et désespérées.
Jouir dans les aigus
Valentin Grimaud est l’auteur de deux monographies aux éditions Le mot et le reste (Mariah Carey, Casta Diva, 2020 ; Céline Dion, Vestale, novembre 2022). Fait rare dans la critique pop, il sait parler de ce qui se passe dans une voix, un chant, et pas seulement en termes de réussite technique. Dans ce texte haut en couleurs vocales, qui complète idéalement l’essai de Julie Ackermann dans ce même numéro, il nous met à l’écoute des nuances d’une technique un peu particulière, presque un gimmick : la « voix de sifflet », ce petit moment de grâce qu’on associe volontiers aux envolées de Minnie Ripperton ou de Mariah Carey. Index des batailles que se sont livrées en chanson et dans leurs trajectoires de célébrités les « divas » pop depuis les années 1990, cette figure sonore en est peu à peu venue à représenter leurs désirs de transgressions — des conventions pop, des identités de genre, et même, comme vous allez le lire, de l’humanité elle-même.
J Dilla, presque à temps
Avec la MPC3000 est venu le temps où les machines s’émancipent de la régularité parfaite qui les définit et les limite. Autour de l’an 2000, James Dewitt Yancey aka Dilla aka Jay Dee (1974 -2006) produisait des rythmes affolants, défaits, « illogiques », décalés au sens propre du mot, qui donnaient à l’auditeur·ice l’impression d’être joués par un « batteur saoul âgé de trois ans », et le plongeaient dans un univers inconnu où l’imprévisibilité aurait pris le contrôle. En libérant le hip-hop de la grille métrique et de ses subdivisions parfaites, il a rendu la programmation plus « humaine que l’humain », donné aux programmeur·euses des degrés de liberté que l’on croyait réservés aux seul·es musicien·nes, et même influencé de nombreux·ses batteur·ses. Le « Detroit Swing » de Jay Dee a depuis essaimé chez des artistes célèbres comme Flying Lotus, Mad Lib, The Roots ou Busta Rhymes. Dan Charnas revient sur sa maîtrise miraculeuse du séquenceur MPC de Akai, sur les tics, les flams, les sextuplets, les hybridations binaires et swingués, paires et impaires, et sur un temps devenu élastique par la voie de la microgrille.
L’ennui avec les musiques improvisées
Si vous avez eu la chance de dormir debout pendant un concert dans une salle comme les Instants Chavirés (Paris), le Buffet Froid (Grenoble) ou la Cave 12 (Genève), ou de laisser votre esprit chavirer jusqu’à ne plus rien remarquer de ce qui se jouait vraiment sur scène, vous vous en souvenez peut-être aussi, comme nous, comme l’un de vos meilleurs souvenirs de musique. Recevoir ce texte de Thomas Dunoyer de Segonzac, auteur pour Revue & Corrigée et taulier du label No Lagos, fut un petit moment d’émotion en plein lent déconfinement, à rapprocher du visionnage du documentaire « Le rock aux Instants Chavirés (ou comment en finir avec le jazz) » d’Yves-Marie Mahé (disponible en ligne). La musique est parfois là pour abolir la musique. On peut habiter avec elle un espace où la poésie, l’émeute, la conscience modifiée, et la conversation d’à côté ne sont plus dans les marges — et où ces marges ont envahi le centre. On y est bien.
Penser hardcore
Depuis quelques années, certain·es musicien·nes raccrochent leur production à des idées comme le « hardcore continuum » ou l’« hantologie » pour en faire les livrets d’une sorte de nouvelle musique à programme : sur Bandcamp, plus d’une vingtaine de références portent l’étiquette « hardcore continuum », et celle d’« hauntology » beaucoup trop pour qu’il soit possible de les décompter. Ces idées ont pris forme dans les années 1990, autour des écrits de Simon Reynolds et du CCRU, un pseudo-laboratoire éphémère rassemblant Nick Land, Sadie Plant, Kodwo Eshun, Mark Fisher ou encore Steve Goodman. Comme le repère Reynolds dans son article « Conceptronica », la manière dont elles sont utilisées aujourd’hui frôle parfois l’exercice académique, sur fond d’un appétit du milieu de l’art contemporain pour la théorie et les subcultures musicales, alors que c’est justement l’académisme que le CCRU s’employait à faire exploser. En tant qu’éditeurs « formés » par les raves et les clubs, et au moment où une bonne part des membres du CCRU sont passé·es à autre chose et où il fait l’objet d’une transmission/canonisation (y compris avec Hardcore de Reynolds, paru chez nous fin août !), il nous a paru important de comprendre quelle fut vraiment la place de la musique pour ces intellectuel·les. Iels semblent y avoir puisé des forces pour radicaliser leur propre rapport à l’écriture et à la théorie, en ouvrant des brèches, mais aussi des fausses pistes.
Audimat 18

Découvrez aussi
Au-delà de l'idéologie de la Silicon Valley
https://audimat-editions.fr/media/pages/catalogue/teque-4/81ebe360be-1710157762/teque_04_cover_web.png
16
teque-4
3
Papier
A paraitre le 19 avril 2024
16 €
Ajouter au panier
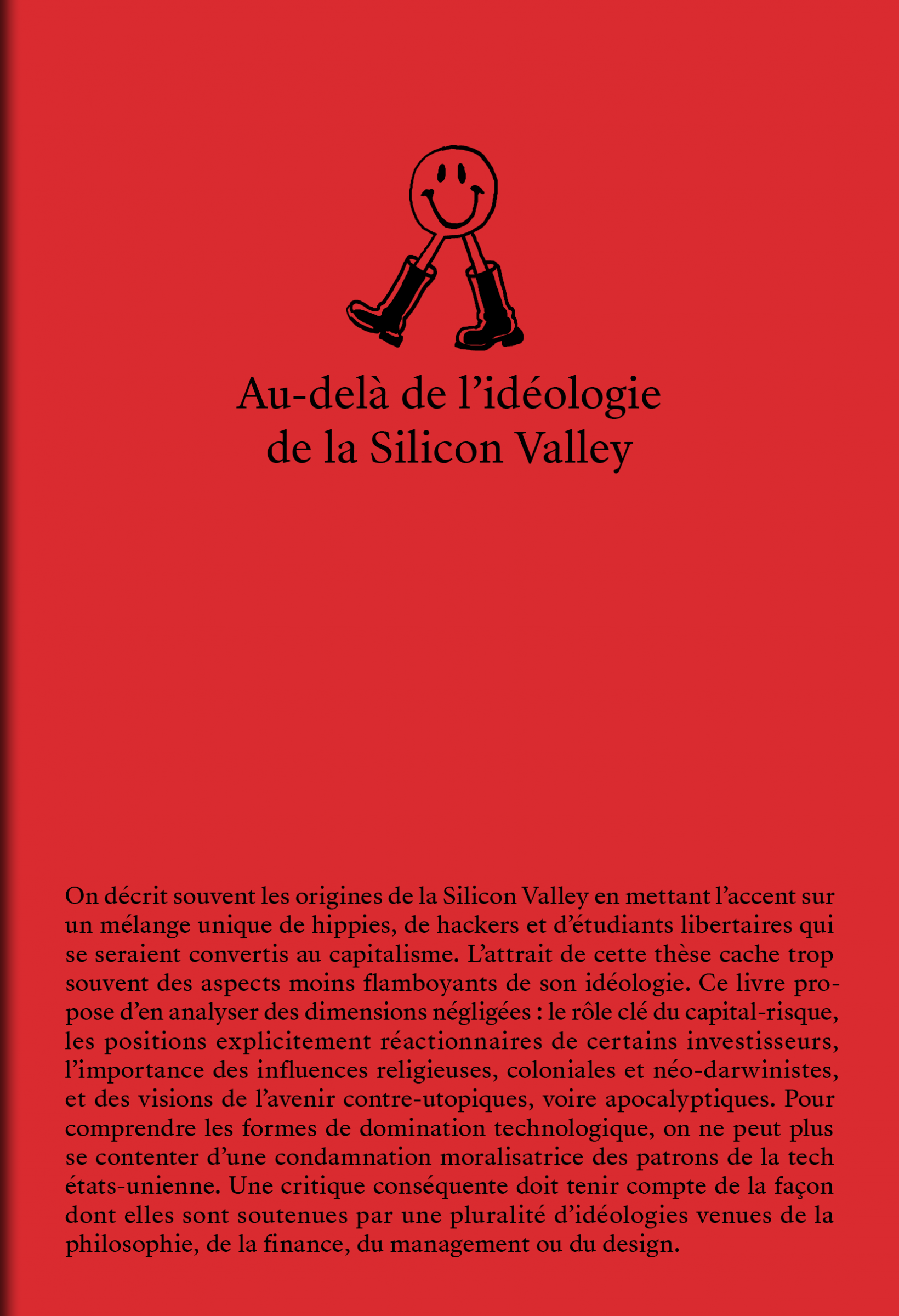
https://audimat-editions.fr/media/pages/catalogue/teque-4/81ebe360be-1710157762/teque_04_cover_web.png
Musique Journal
https://audimat-editions.fr/media/pages/catalogue/musique-journal-2/43c8d7ab73-1670235935/musique-journal_zine_2022_website.png
5
musique-journal-2
0
Papier
5 €
Ajouter au panier

https://audimat-editions.fr/media/pages/catalogue/musique-journal-2/43c8d7ab73-1670235935/musique-journal_zine_2022_website.png