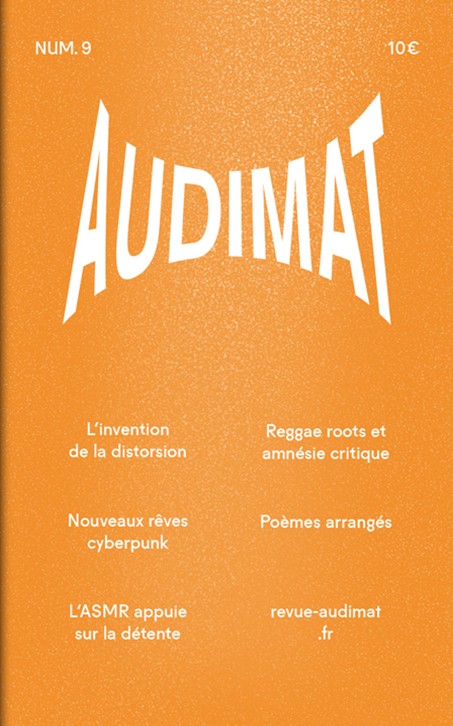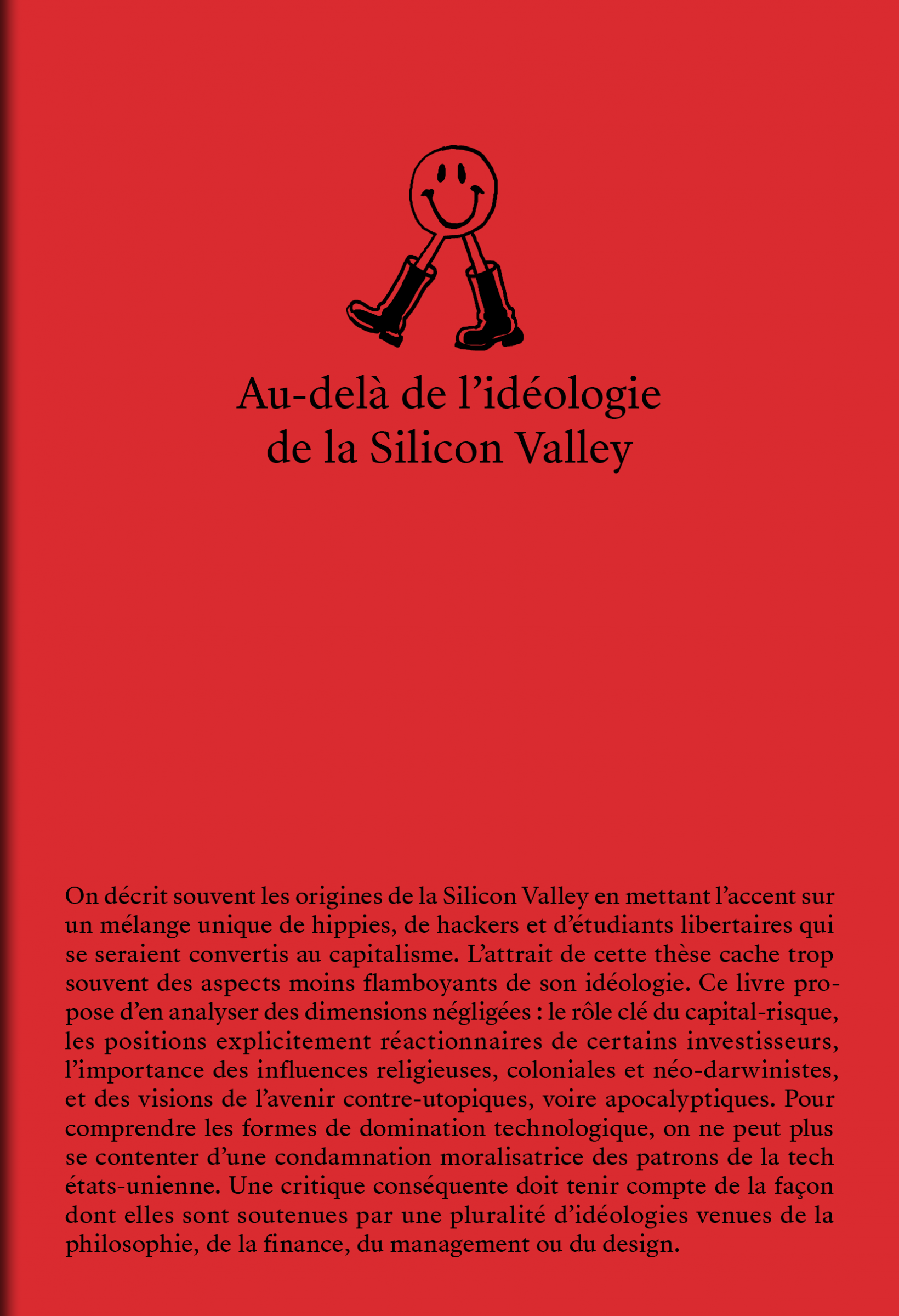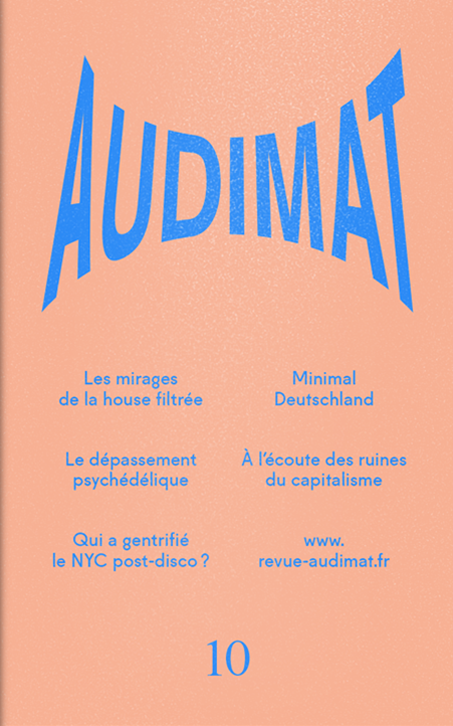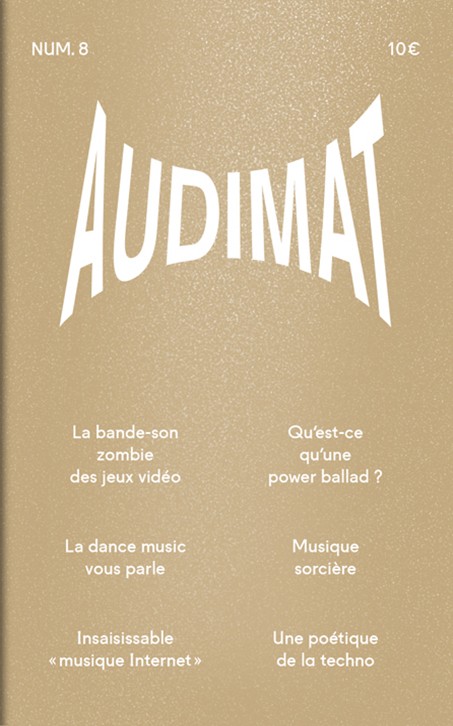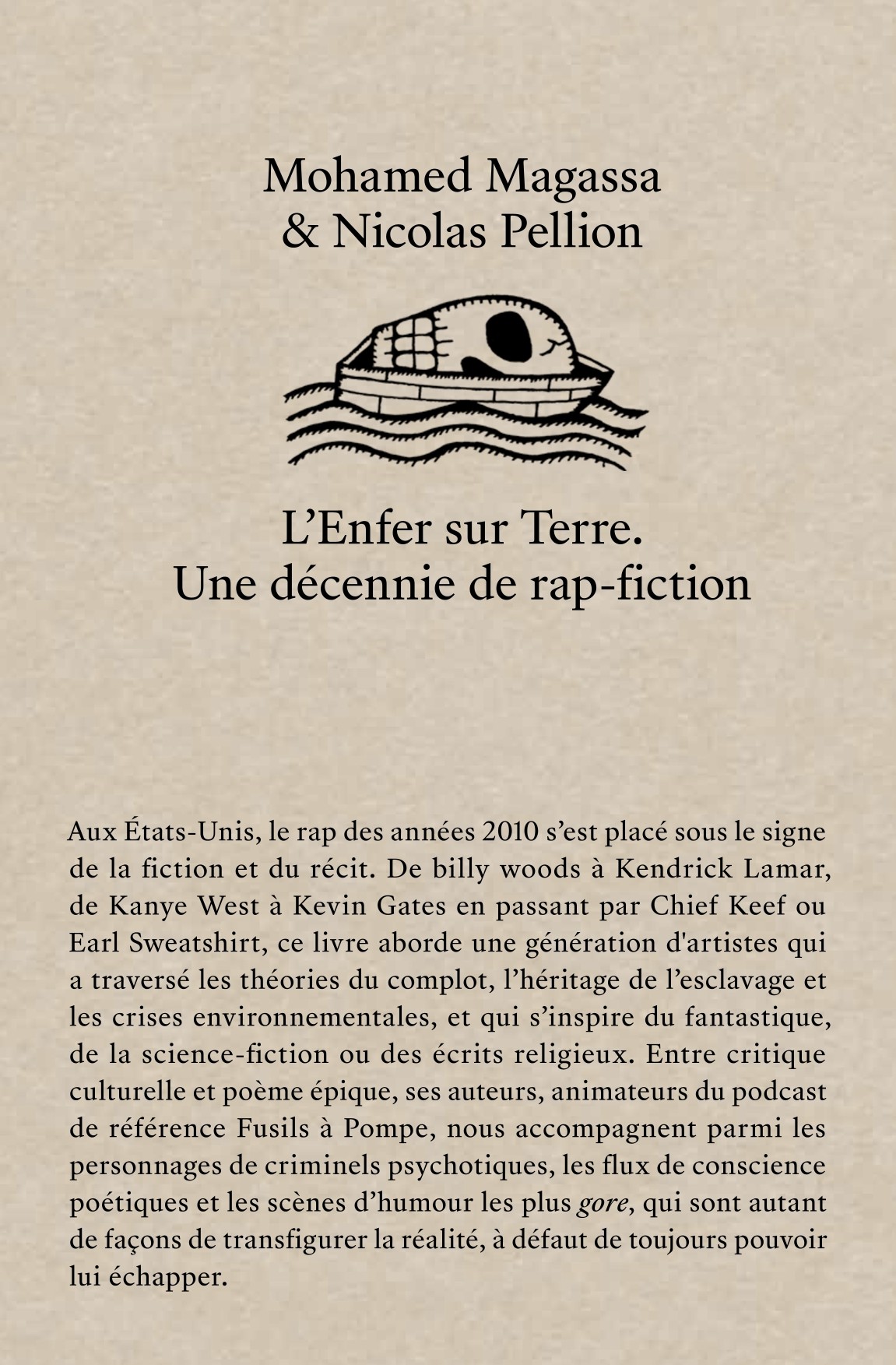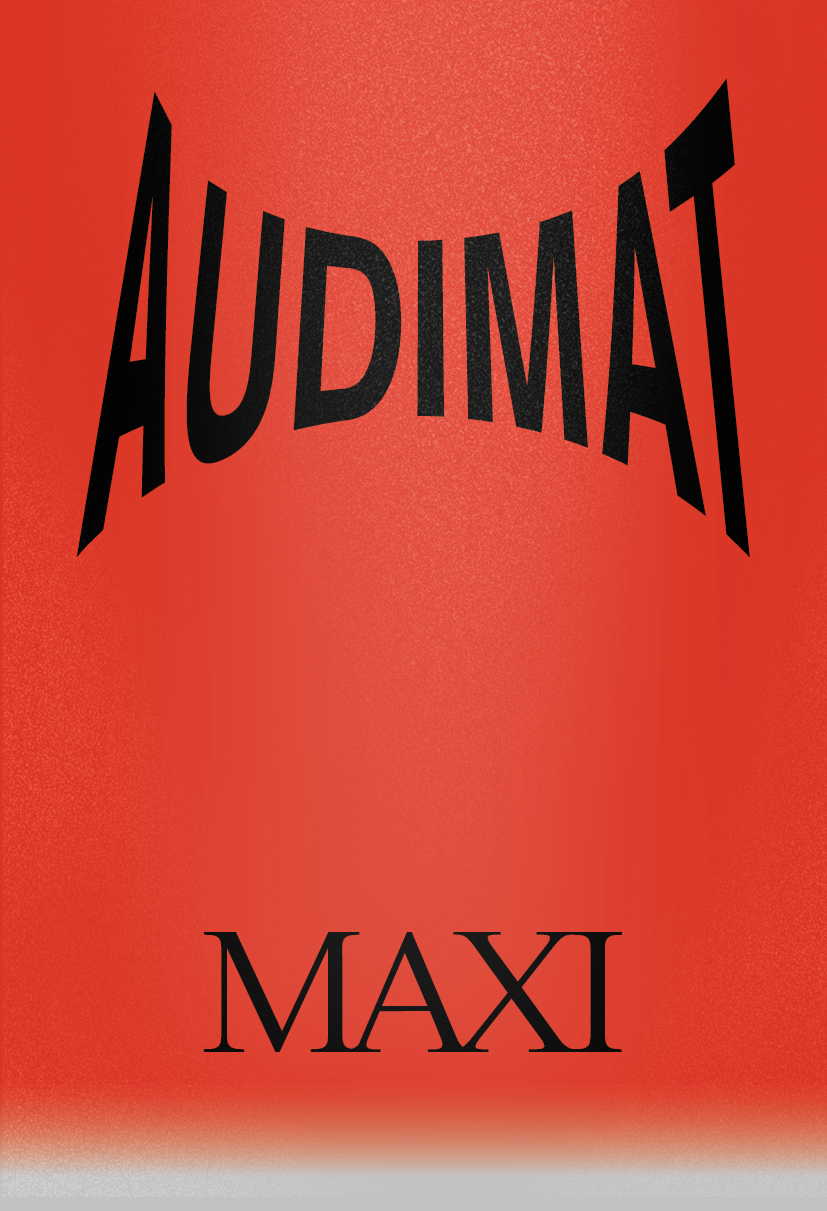Overdrive : théorie d’une sonorité électrique
Pierre Arnoux
La question de « l’essence du rock » a tendance à crisper les esprits dans d’infernales polémiques. Pierre Arnoux, philosophe au Collège International de Philosophie, nous propose ici l’aborder par la bande – c’est le cas de le dire – en se concentrant sur la notion de distorsion. Loin de n’être qu’une question technique, le dispositif sonore de l’overdrive est pour lui un mélange de mouvement et d’idéal. Là où « la » distorsion apparaît souvent comme un symbole de la révolte sociale ou de l’intensité sonore, Arnoux explique comment les différentes façons de « faire distorsion » correspondent en réalité à une panoplie de conditions, de décisions, de gestes. Une combinaison guitare-pédale, un morceau de musique, un musicien et sa manière de repousser ou de jouer avec les limites : tous sont les relais d’un même organe ou d’un même circuit, dont la distorsion constitue le cœur et les rouages. Une même énergie et un même désir les traversent, qu’en retour ils modulent, chacun à leur manière, et si la distorsion a de multiples moteurs, ses feedbacks sont sans fin.
Nouveaux rêves cyberpunk
Philippe Llewellyn
À la lecture du premier jet de ce texte enthousiaste et touffu qu’un inconnu et novice du nom de Philippe Llewellyn nous avait envoyés l’an dernier, nous avions regretté d’avoir trop vite méprisé la microscène vaporwave, née au début de notre décennie. Ne serait-ce que parce que ce mépris nous avait fait louper les horizons hardvapour et dreampunk suggérés au genre par le label Dream Catalogue, sujet principal de l’article. Au passage, Llewellyn évoquait avec passion l’esthétique cyberpunk – ses films fondateurs, leurs bandes originales, leurs villes rêvées ou réelles. Nous lui avons donc demandé de greffer à sa monographie quelques éléments d’une histoire de la musique cyberpunk. Loin de faire interférence, les images et les références qui accompagnent les sorties discographiques de Dream Catalogue lui donnent toute sa dignité, celle d’une bande-son d’imaginaires dont elle est absolument solidaire. Et loin de ne constituer qu’une série de codes rebattus, ces imaginaires fonctionnent comme une réactualisation toujours plus abstraite et mélancolique de ce que le cyberpunk a laissé flotter dans notre inconscient collectif. Au moment où Blade Runner et Ghost In The Shell font réapparaître sur nos écrans des réplicants et des simulacres au carré, les artistes affiliés au label recyclent un réseau de références plus dense qu’il n’y paraît. Ils y puisent des émotions toutes prêtes, certes, mais qui n’ont rien de naïves. Pour Llewellyn, les musiciens cyberpunk d’aujourd’hui, plutôt que d’imaginer un futur radicalement nouveau, choisissent de fouiller entre les mailles du futur et du passé, de la ville mondiale et de ses marges ghettoïsées, et s’ils traversent les clichés, c’est pour un jour mieux imaginer de nouvelles utopies.
Générer l’euphorie en ligne : l’esthétique de la culture ASMR
Rob Gallagher
Les vidéos ASMR décollent le mince papier peint de nos certitudes du triste mur de la vérité absolue. Ces séances de fétichisme sonore (et relationnel) aux vertus relaxantes, que l’on trouve en masse sur YouTube, bousculent voluptueusement notre perception des frontières entre la musique et le reste du monde audio, qui souvent la déborde. Elles réactivent notre rapport aux supposés effets thérapeutiques du son, aux images vidéo, aux jeux de rôles, aux objets, aux bases de données. Rob Gallagher, jeune chercheur britannique passionné par la portée des techniques vocales, a décidé d’analyser ces pratiques ésotériques, parfois érotiques, et qui en laissent certains franchement sceptiques. Qu’ont-elles à voir avec la musique, ou du moins avec l’expérience et les propriétés de la musique ? D’un certain point de vue, l’ASMR serait le plaisir d’éprouver la texture sonore, jusqu’ici souvent réservé aux esthètes de la musique concrète, de la techno et du sound design, qui se déploierait désormais vers un nouveau monde de sensations accessibles au plus grand nombre. Mais d’un autre point de vue, l’ASMR signerait la fin de l’écoute, remplacée par une mécanique des « déclencheurs » (triggers) qui rappelle à la fois la muzak, les panoplies de gadgets pour thérapie personnelle, les playlists « Humeurs » sur Spotify. Alors appuyons ensemble sur le bouton « perplexité » et voyons ce qui se passe.
One step forward, two steps back : reggae roots et amnésie critique
Neil Kulkarni
Une bonne remise en question radicale ne fait jamais de mal, surtout quand elle porte sur un sujet qu’Audimat n’a guère abordé jusqu’ici – le reggae – mais qui nous intrigue confusément et qui, du même coup, génère certains fantasmes et impose à la vue quelques angles morts. Neil Kulkarni, un Anglais aussi passionné de rap que de groupes post-shoegaze comme Insides ou Disco Inferno, signe ici un article (au départ paru en 2016 sur le site The Quietus) qui met en évidence le révisionnisme, ou du moins les lourds préjugés et l’amnésie partielle dont est victime l’histoire du reggae dans son traitement par la critique occidentale, en général blanche et issue des classes moyennes. Fasciné par la psychédélie sonore du dub, le connaisseur-esthète-muséographe aurait en contrepartie tendance à mépriser le reggae « de base », celui qui ne saurait être distingué de l’environnement social, spirituel et politique qui définit la Jamaïque. Tâchant pour sa part de ne plus évacuer le réel au profit de la volupté sonore, Kulkarni propose donc de considérer trois disques selon lui majeurs mais bien trop peu cités – tous sortis en 1976 et signés par les Mighty Diamonds, Max Romeo et les Gladiators – en revenant sur la situation de l’île à l’époque : crise économique, guerres des gangs, soupçons de manœuvres de la CIA, et instrumentalisation du reggae et du rastafarisme à des fins politiques dans une période électorale plus que tendue. Son point de vue, nourri d’autocritique, suggère donc qu’il est toujours délicat pour les Occidentaux de parler doctement de ces musiques pourtant inscrites malgré elles à ce curieux patrimoine culturel du bon goût « branché ». Mais comme nous l’a très justement suggéré le traducteur du texte, le musicien français Slikk Tim, cette autocritique mériterait elle-même sans doute sa propre critique. On vous laisse en juger, en nous disant tout de même que cette tension entre surplomb et culpabilité se devra d’être abordée de front dans nos pages, quand le time sera right, pour citer les Mighty Diamonds.
Poèmes arrangés : pourquoi fouiller jusque dans le bac diction
Fanny Quément
Après les ambivalences de l’ASMR, entrons à présent dans une autre « zone mixte », celle de la poésie lue et enregistrée. Fanny Quément est docteur en littérature anglophone et traductrice spécialisée en poésie irlandaise contemporaine. En parallèle, elle officie en tant que DJ sous les noms de Lolo Tuerie et DJ*** et a rassemblé au fil des années une vaste et anarchique collection de disques de poèmes lus, d’exercices de diction, de pièces littéraires mises en musique, et de bien d’autres choses encore. Cette récolte informelle quoique joyeusement obsessionnelle l’a amenée à comprendre et aimer la poésie lorsqu’elle est lue et déclamée sur 33 tours, elle qui jusque là n’appréciait pas tellement en lire sur papier. Partant, elle nous a proposé d’écrire un texte sur cette expérience, qui tient à la fois de la balade glaneuse, de la recherche discographique à contrainte auto-imposée et de la réflexion sur le jugement intime et l’étrange résonance affective d’un texte lu et accompagné de musique. C’est aussi l’occasion pour nous de découvrir ou redécouvrir des scènes et des moments oubliés de notre histoire musicale récente, à une époque où le monde de la poésie croyait encore à sa diffusion populaire.