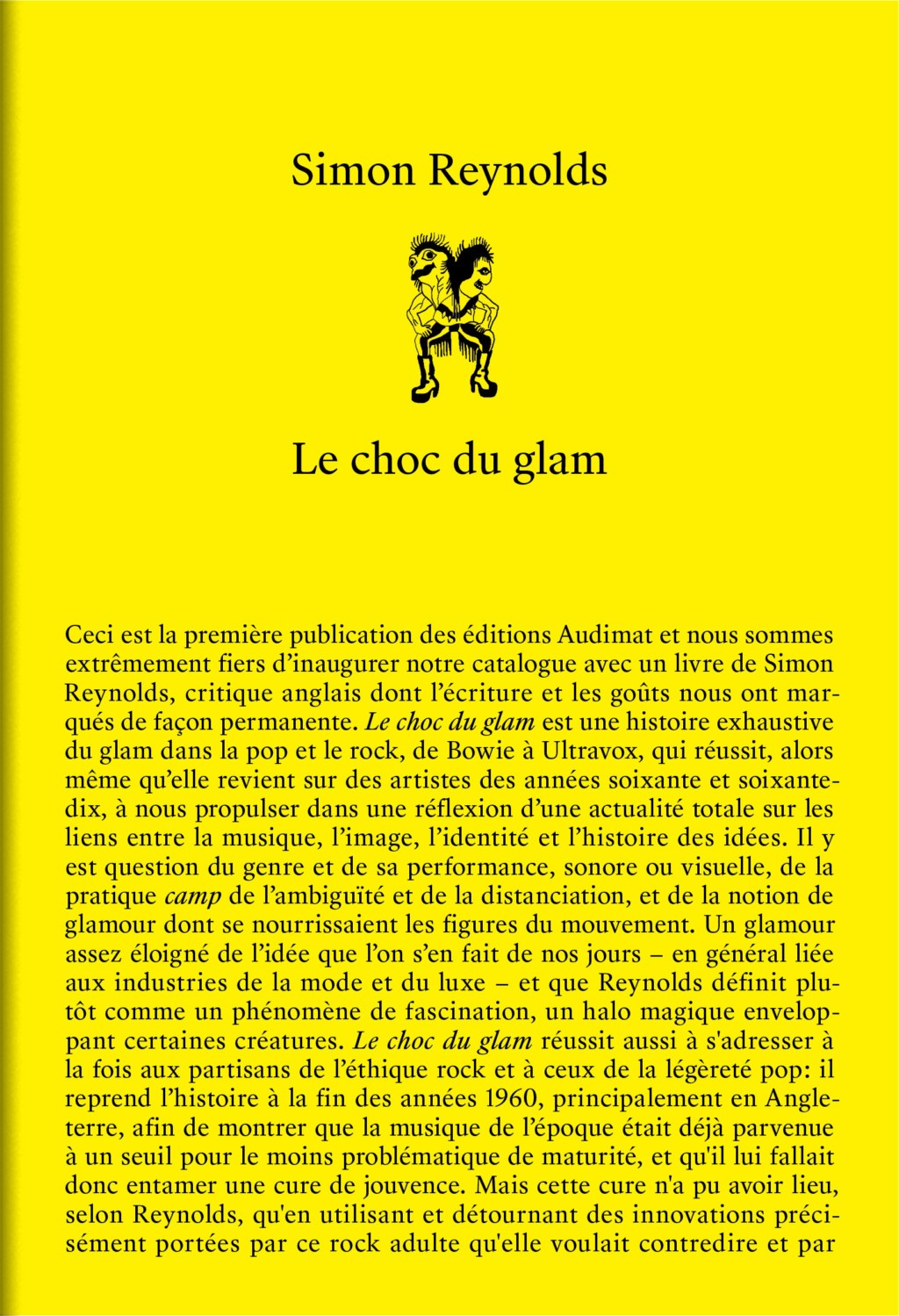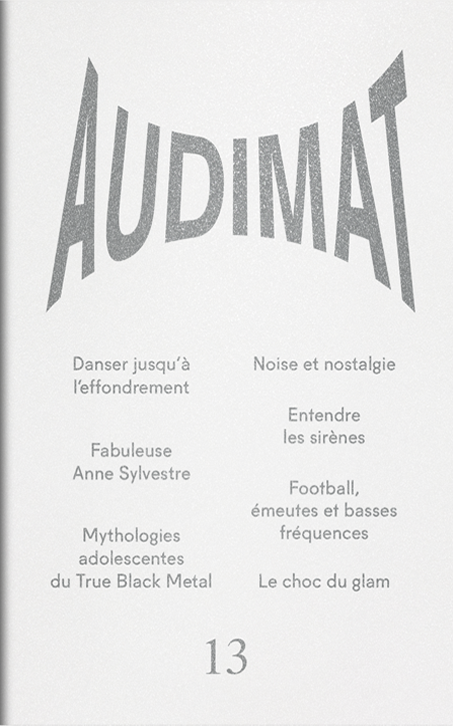Depuis son numéro 0, Audimat a déjà publié pas moins de quatre textes de l’Anglais Simon Reynolds. Mais celui qui va suivre a une importance particulière pour nous puisqu’il est un avant-goût de la traduction de son dernier livre, Shock & Awe : Glam Rock and Its Legacy, qui inaugure la maison d’édition que nous lançons. Nous sommes profondément fiers de cette première sortie. Bien sûr parce que Reynolds est sans doute pour nous l’un des deux ou trois plus grands critiques musicaux en activité et que ses écrits sont pour beaucoup dans ce que nous faisons avec Audimat. Mais aussi parce que cette histoire exhaustive du glam rock réussit, alors même qu’elle revient sur des artistes des sixties et seventies, à nous propulser dans une réflexion d’une actualité totale sur la culture et la société. Il y est question du genre et de sa performance, évidemment, puis, très vite, de la « queerisation » des formes instituées, de la pratique camp de l’ambiguïté et de la distanciation, et de la passion – au sens étymologique de pathos, « souffrance », « maladie » – du glamour, du fétiche, du halo, tant sonore que visuel. Shock & Awe, dont nous vous proposons donc ici de lire les premières pages, a également l’immense mérite de savoir à la fois parler aux vieux « rockistes » et aux jeunes « poptimistes » : il reprend l’histoire du rock (principalement anglais) à l’extrême fin des années 1960 afin de montrer que le genre était déjà parvenu à un seuil pour le moins problématique de maturité, et qu’il lui fallait donc entamer une cure de jouvence et de légèreté. Mais cette cure n’a pu avoir lieu, selon Reynolds, qu’en se nourrissant des innovations précisément portées par ce rock adulte qu’elle voulait contredire. Un jeu dialectique entre progrès et régression, effet immédiat et profondeur, qui guide peu ou prou tout ce qui nous stimule et nous charme dans nos explorations de critique, et que l’on trouve plus que jamais au cœur de cet ouvrage – lequel, nous l’espérons, saura capter l’attention d’un public plus large que celui des seuls mélomanes !
Pour moi, la pop music a commencé quelque part entre « All You Need Is Love » des Beatles et « Hot Love » de T. Rex. Et ce commencement a eu lieu, pour l’essentiel, sur l’écran de la télévision, s’offrant à moi par le biais des émissions pour enfants et de Top of the Pops.
Au cours de ses quatre décennies d’existence, le capharnaüm de nouveautés et de tubes en puissance qui caractérisait Top of the Pops a donné lieu à une procession hétéroclite où se mêlait artistes grand public, chansons comiques et pop strictement professionnelle. Mais au début des années 1970, la balance penchait nettement en faveur des dingues et des allumés. La pop britannique était envahie par l’absurde, l’excessif et le grotesque. L’émission faisait presque mal aux yeux tant elle était criarde, et ce même pour la majorité de foyers au Royaume-Uni qui la regardaient encore en noir et blanc.
C’était notre cas : nous possédions un petit téléviseur en noir et blanc. Ma famille n’a pas eu de poste avant mes huit ans, en 1971, et le glam est donc la première expérience de la pop dont je me souviens clairement. Je ne savais pas que le glam était du glam, qu’il désignait une période distincte et bien définie de la pop. Ce que je voyais sur l’écran de la télé était simplement la pop telle qu’elle était alors : extrême et fantastique, à la fois idiote et terrifiante.
L’un de mes tout premiers souvenirs pop est le choc visuel et sonore suscité par la découverte de Marc Bolan interprétant « Children of the Revolution » à Top of the Pops, ou peut-être était-ce « Solid Gold Easy Action ». Plus encore que la sensualité menaçante du son de T. Rex, c’était le look de Marc Bolan qui m’avait subjugué. Sa chevelure électrique, ses pommettes constellées de paillettes, un manteau qui semblait fait de métal : Marc ressemblait à un seigneur de guerre venu des confins de l’espace.
Étincelle initiale de l’explosion glam, Marc Bolan avait très rapidement eu des disciples. Il y avait eu l’insurrection plastique de Sweet. Le bubblegum barbare de Gary Glitter. Le tapage jubilatoire de Slade. Le vacarme chamarré de Wizzard, tout en cuivres et cheveux teints. La grandiloquence et le maniérisme de Roxy Music. Alice Cooper, le Joueur de flûte démoniaque. Les outrances bravaches des Sparks. Et, au beau milieu de tout ça, David Bowie, prêt à conquérir la décennie comme les Beatles l’avaient fait avec les années 1960, trustant les hit-parades avec élégance et étrangeté. « Space Oddity » – ressorti en 1975 pour lui offrir son premier numéro un – avait produit une impression indélébile sur le jeune garçon que j’étais.
Cet idéal pop façonné par le glam – celui d’une musique extraterrestre, fulgurante, hystérique dans tous les sens du terme, un lieu où fusionnent le sublime et le ridicule au point d’en devenir indiscernables – ne m’a jamais quitté.
J’ai redécouvert le glam au milieu des années 1980, époque à laquelle j’étais devenu un passionné de musique et un critique en herbe. À ces premières impressions, gravées de manière diffuse dans mon esprit d’enfant, se superposaient désormais des idées plus réfléchies et conceptuelles : le sentiment que quelque chose avait été perdu quand le punk et le post-punk avaient inexorablement démystifié et dévoilé les rouages du spectacle. En jouant les vieux 45 tours que mes amis et moi dénichions dans les boutiques d’occasions et les vide-greniers – des chansons de The Sweet, Glitter, Hello, Alice Cooper –, je sentais le pouvoir de fascination d’un temps où la pop était surhumaine, idolâtre, démente, un vrai théâtre d’artifices enflammés et de gestes grandioses. Une période disparue depuis longtemps et pour de bon qui semblait en totale contradiction avec ce que la pop était devenue dans les années 1980, à l’heure du post-post-punk : adulte, responsable, bienveillante et socialement engagée.
Le terme glam – ou glitter aux États-Unis – désigne un ensemble d’artistes et de groupes, bien souvent galvanisés par une rivalité amicale, collaborant ensemble et partageant bien souvent leurs managers. Le glam renvoie également à une sensibilité, à l’esprit de l’époque qui débuta vers le début des années 1970 et régna durant quatre ans avant de se flétrir peu de temps avant l’explosion punk. Au-delà de cette réalité historique généralement acceptée – en tant que période, genre, scène, mouvement –, le glam peut également s’envisager comme un continuum qui englobe aussi bien des précurseurs au sein du rock (les Rolling Stones, le Velvet Underground, Little Richard, entre autres) que des ancêtres précédant le rock’n’roll et formant une généalogie remontant jusqu’à la fin du XIXe siècle, voire encore plus tôt. Aujourd’hui, pour certains fans, critiques et artistes contemporains, le glam est un véritable credo, voire une cosmologie : le prisme au travers duquel ils appréhendent tout ce qu’ils admirent dans la musique et la culture pop.
Dans ce livre, le glam est envisagé comme une catégorie extensible qui couvre tous les candidats « naturels », mais également plusieurs représentants moins évidents issus de l’art-pop et du rock « théâtral », parmi lesquels The Sensational Alex Harvey Band, The Tubes ou Queen. À l’image de la plupart des scènes et des genres musicaux, le glam est une nébuleuse qui déborde sur d’autres catégories tout aussi floues telles que le teenybop, le rock progressif, les singers-songwriters ou le hard rock. En tant que période historique, le glam s’avère tout aussi trouble : d’un côté, des artistes comme Bowie, T. Rex, Alice Cooper et Roxy Music ont émergé de l’underground hippie et ont mis un moment à se défaire de leurs tendances post-psychédéliques ; tandis que, de l’autre, nombre de figures du glam plus tardif montrent la voie vers le punk ou connaîtront même une seconde carrière avec la New Wave au terme des années 1970. Plutôt que d’en offrir une définition stricte, j’ai interprété le terme « glam » le plus largement et le plus librement possible, en suivant la musique, ses histoires et figures de proue là où elles semblaient vouloir aller.
Un plus vaste problème taxonomique mérite toutefois d’être abordé : qu’est-ce qui distingue la splendeur du glam du cirque habituel de la pop music ? Après tout, l’élégance, les chorégraphies scéniques et le spectacle constituent, des éléments centraux de la pop, en particulier, et du show-business, en général. La différence fondamentale se situe dans le fait que les artistes glam adoptaient en toute conscience costumes, accessoires et théâtralité. Des aspects qu’ils utilisaient, bien souvent, afin de parodier le glamour plutôt que d’y adhérer sans réserve. C’est par son côté artificiel que s’était fait remarquer le glam rock : ses acteurs étaient despotiques, ils dominaient leur public, comme le font tous les véritables entertainers. Mais ils se livraient aussi volontiers à une espèce de déconstruction ironique de leurs propres personnages et de leurs poses, tournant en ridicule leur prestation scénique.
Le glam rock portait en emphase le glamour qui le caractérisait, car il se voulait une réaction contre ce qui l’avait précédé. L’anti-glam du rock adulte et mal fagoté des années 1968-1970 est ce qui a rendu le geste glam à la fois possible et pertinent : l’adoption provocatrice du clinquant, de la frivolité et de la folie. Les années 1968, 1969 et 1970 – l’époque d’Abbey Road, Music From Big Pink, Atom Heart Mother, At Fillmore East, Déjà Vu, Tommy, Blind Faith – ont vu le rock arriver à maturité, laissant derrière lui ces enfantillages qu’étaient les 45 tours ou l’imagerie pop. Les stades comme les ondes étaient dominés par le country-rock doucereux, les singer-songwriters sincères, les groupes hippies aux habits couleur taupe et aux improvisations interminables et une cohorte de groupes bluesy-boogie au look indéfinissable. Qu’ils soient roots ou sophistiqués, tous ces groupes semblaient d’accord sur une chose : le rock, c’était la musique et rien que la musique. S’intéresser à son image ou chercher à faire le show était jugé puéril, ringard et commercial.
En se dressant devant ce morne paysage de barbes et de denim, le glam rock fut le premier véritable déchaînement adolescent de la nouvelle décennie. À certains égards, il ressuscitait l’esprit originel des fifties, quand le rock’n’roll se regardait autant qu’il s’écoutait : la flamboyance camp de Little Richard, le jeu de scène tonitruant de Jerry Lee Lewis. Pour parvenir à un impact audiovisuel équivalent, les glam rockers durent aller encore plus loin. Exacerbant les tendances androgynes et homoérotiques déjà présentes dans la pop des années 1950 et 1960, flirtant avec de nouvelles convulsions déviantes et décadentes, les artistes glam usaient et abusaient de costumes extravagants et de provocations savamment mises en scène pour laisser leur public dans un état de sidération.
Sur le plan sonore, le glam était aussi un retour en arrière, une redécouverte de la simplicité du rock’n’roll des fifties et de l’agressivité des beat groups de la première moitié des sixties. Le glam, finalement, mettait en scène une inversion complète du schéma du rock heavy et chevelu qui l’avait précédé : fini la virtuosité et les habits passe-partout, place aux excès visuels sur fond de rock dépouillé.
Ce qui a empêché le glam de n’être qu’un rock régressif, un simple revival ou une reconstitution du passé tient à sa perméabilité aux avancées des années 1960, où survinrent des changements considérables dans la manière dont sonnaient les guitares et dont les batteries étaient enregistrées. Le résultat fusionnait primitivisme et raffinements de production, combinant de façon saisissante le sous-humain et le surhumain. À la fois flash-back sur les fifties et préfiguration du punk à venir, le glam a atteint des sommets d’innovation entre les mains de Mike Chapman, Mike Leander, Phil Wainman et Jeff Wayne, patrons d’usines à tubes bien huilées. Leurs disques étaient si élaborés qu’ils semblaient posséder une dimension visuelle. Chaque single à succès faisait l’effet d’une pièce de théâtre chez les auditeurs. Il s’agissait d’une musique « faite pour être regardée autant qu’écoutée », pour reprendre les mots de Chapman.
Le glam a également réussi à inverser les principes politiques et philosophiques qui régissaient le rock hippie de la fin des années 1960. Balayant d’un revers de main l’esprit communautaire obsolète de l’underground, les tenants du glam n’entendaient pas s’unir pour changer le monde, mais recherchaient plutôt une échappatoire individuelle à la réalité pour atteindre un fantasme de gloire et de folie absolues. Ils étaient animés par une obsession teintée d’ironie, mais, au fond, très sérieuse pour la célébrité ainsi que tous les signes extérieurs de richesse et le luxe ostentatoire qui l’accompagnent. En rupture avec les convictions de la génération libérée aux cheveux longs, le glam célébrait l’illusion et les masques plutôt que la vérité et la sincérité. Les idoles glam – Bowie, Alice Cooper, Gary Glitter, Bryan Ferry et consorts – adhéraient toutes à l’idée que la figure apparaissant sur scène ou sur disque n’était pas une personne réelle mais une fabrication, une chimère qui n’avait pas nécessairement de lien avec la véritable identité des artistes ou leur style de vie quotidien.