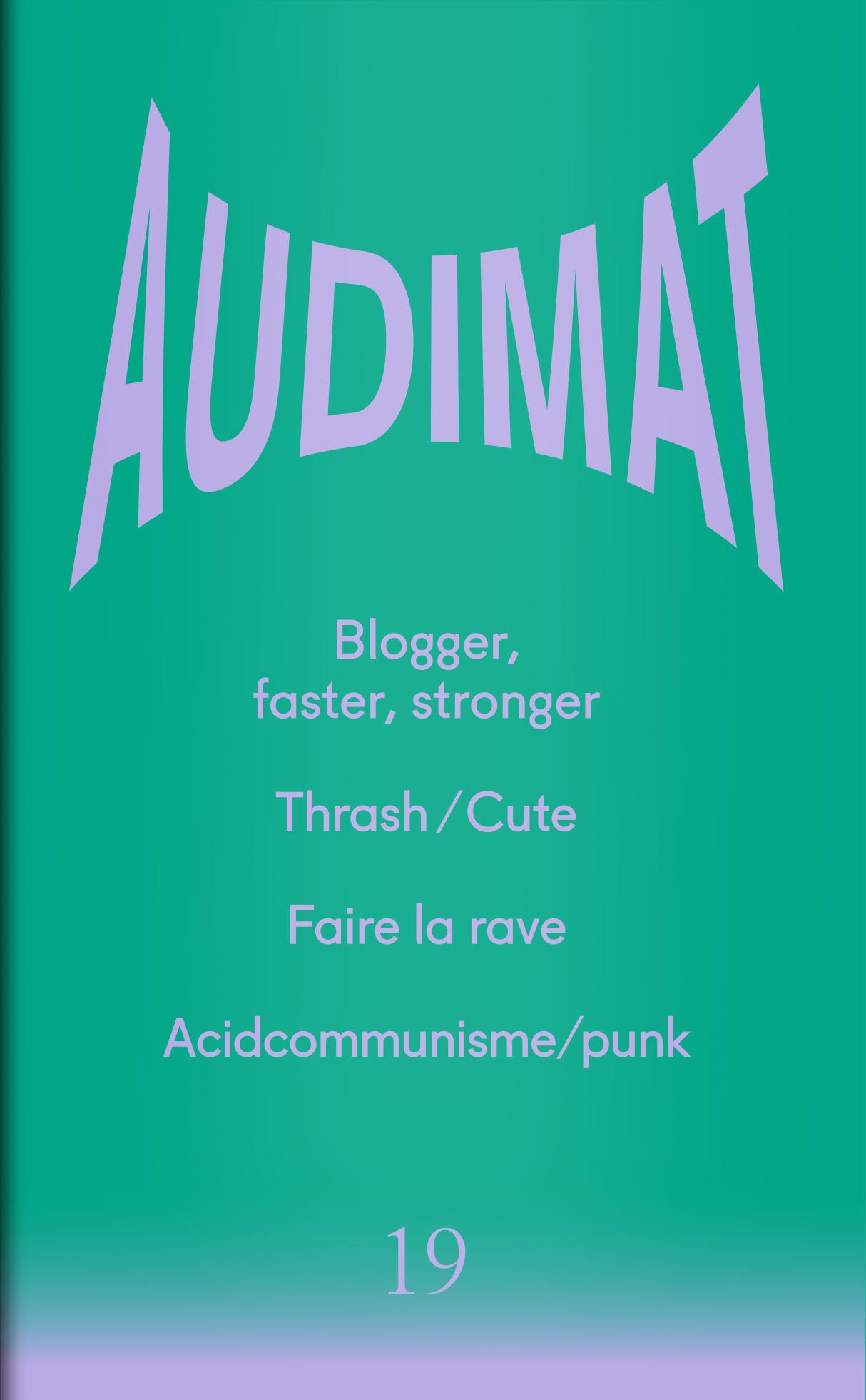Partie 1 : L’impasse de l’approche managériale.
Enseignant, chercheur et compositeur, François Ribac est un spécialiste des rapports entre musique et écologie, même si le mot de spécialiste convient assez mal à son style de pensée. Il cherche en effet souvent à déconstruire le privilège des experts et les écueils d’une recherche académique à oeillères. Depuis de nombreuses années, il montre comment l’idéologie de l’innovation trouve une partie de ses appuis dans l’histoire de la musique occidentale, et comment il est difficile de comprendre la musique sans en passer par une histoire très large des technologies et des infrastructures du spectacle et de l’enregistrement. Le texte que vous allez lire fait suite à une rencontre à European Lab organisée par nos camarades de Technomaterialism. Les invités y avaient confronté leurs visions divergentes de ce que signifierait une transformation écologique du monde de la musique, et François Ribac s’y était opposé à l’horizon posé par les chartes écoresponsables, l’approche « RSE » (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et les outils informatiques pour comptabiliser « l’impact carbone » des festivals.
Si la discussion sur la stratégie ou l’attitude politique qui permettrait de sauver nos milieux de vie est en cours dans la pensée critique et écologique en général, le monde professionnel de la musique se vit parfois encore comme une activité vertueuse dont il suffirait d’optimiser « l’empreinte carbonne ». Ce texte cherche donc à nous faire gagner du temps. En commençant par analyser les limites du solutionnisme technologique, de la comptabilité verte et la tendance à confier aux seuls acteurs économiques la gestion des questions écologiques et sociales, il nous évite de nous laisser séduire par le recyclage de pseudo-solutions déjà remises en question par de nombreuses recherches. Dans une seconde partie, il en appelle à des enquêtes collaboratives qui puissent notamment inclure les personnes précarisées par le secteur des musiques actuelles (ce qui concerne autant le plan de l’écologie et de la santé que le plan social), ainsi que celles et ceux qui sont déjà engagées dans des pratiques de réflexion et de soin, dans les milieux de la musique comme au-delà.
(La rédaction)
Introduction
Lors de l’été 2022, des chaleurs intenses, des sécheresses, des incendies et des tempêtes ont fortement affecté le déroulement d’événements musicaux en Europe. En juin 2022, lors du festival Hellfest, la chaleur caniculaire a amené la sécurité civile à ouvrir un poste de secours tandis que les organisateurs arrosaient les spectateurs/trices devant les scènes[1] : 800 spectateurs ont été victimes de malaises. À l’autre bout de la France, en juillet, de très fortes intempéries ont endommagé une partie des installations du festival des Eurockéennes de Belfort, il a fallu évacuer les festivaliers et annuler les deux premières journées du festival : 7 personnes ont été blessées[2]. Quelques semaines plus tard, au festival de musiques électroniques Medusa, près de Valencia en Espagne, une scène s’est effondrée durant une tempête. Bilan : 40 blessé. e. s et un décès[3]. D’autres types de festivals ont également été exposés à des périls comparables. Lors du festival d’Avignon, du 7 au 26 juillet 2022, un très violent feu a détruit plus de 700 hectares à quelques kilomètres de la Cité des Papes. Des photos postées sur les réseaux sociaux et des articles de presse ont montré l’immense panache de fumée qui flottait au-dessus de la ville. L’incendie monstre a entraîné le blocage de lignes de trains et de routes et contraint les festivaliers à effectuer de longs détours afin de quitter ou de rejoindre la ville[4]. Ce même été, des incendies se sont répandus dans des régions françaises d’habitude épargnées. Dans un récent rapport, le Copernicus Climate Change Service a répertorié la plupart des évènements extrêmes sur le continent européen en 2022. La mise en corrélation de ces épisodes et de leurs conséquences (raréfaction de l’eau, sécheresses, hausse des émissions des gaz à effets de serre) montre que le changement climatique s’intensifie et que l’Europe semble particulièrement exposée[5].
Cette bascule de l’été 2022 doit également être reliée aux profonds dysfonctionnements durant la pandémie de covid 19. L’immobilisation des chaines logistiques a provoqué des pénuries de matériaux et de ressources et la production et la diffusion de spectacles et de concerts ont été totalement interrompues à plusieurs reprises[6]. Comme lors des épisodes épidémiques précédents (sida, ebola, grippe aviaire ou Sras en 2002-2004), l’apparition du covid 19 résulte de prédations environnementales. La déforestation massive, la multiplication des élevages intensifs, le trafic et la consommation d’animaux sauvages permettent à des virus issus du monde animal de rentrer en contact avec des humains puis, grâce aux circuits de la dernière globalisation, de prospérer. Quelles que soient les hypothèses sur le point de départ de la pandémie de covid 19, fuite accidentelle d’un laboratoire ou contamination via des « animaux intermédiaires » [7], le fait même que le virus ait pu rentrer en contact avec des humains atteste d’une forte dégradation des milieux et montre comment les circuits de la globalisation permettent aux virus de se disséminer. Une conjugaison qui avait été largement anticipée par les scientifiques et qui pourrait se renouveler[8].
Dans un même ordre d’idées, l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a fortement déstabilisé la fourniture d’énergie et entrainé de fortes tensions. Peu imaginable il y a quelques années, le spectre des coupures d’électricité est désormais régulièrement envisagé.
Pour certains analystes, l’extrême fragilité des infrastructures et le dérèglement généralisé et durable du système Terre signifient que le monde s’apparente d’ores et déjà à un champ de ruines[9]. Dans ces conditions, le fonctionnement actuel des mondes musicaux ne semble guère tenable et il semble essentiel que ceux-ci s’adaptent dès maintenant aux menaces déjà présentes et engagent une véritable transformation écologique.
Spectacles à thème, concerts d’alerte et écoresponsabilité
Historiquement, les mondes du spectacle et de la musique ont abordé les questions environnementales (quand c’était le cas), de trois façons principales (qui peuvent se conjuguer) :
- L’exploration par des équipes artistiques de nouvelles relations/connexions avec l’environnement, la nature, l’écologie, les animaux, le vivant. On peut par exemple citer les soundscapes de Bernie Krause et son exposition de 2016 à Paris Le Grand Orchestre des Animaux qui suggère que ce sont les animaux qui ont initié les humains à la musique[10].
- Une posture d’alerte où les artistes alertent sur la dégradation de l’environnement. Live Earth, une série de concerts et de retransmissions à l’échelle planétaire de groupes pop organisés en 2007, est un peu le point culminant de cette démarche de conscientisation débutée au début des années 1970 avec le Concert pour le Bangladesh de George Harrison et Ravi Shankar (1971) et s’est poursuivie lors des décennies suivantes[11].
- Une approche inspirée du développement durable (une notion popularisée par le rapport Brundtland pour l’ONU en 1987[12]) qui comporte généralement deux dimensions. D’une part, inciter les spectateurs/trices à limiter l’impact de leurs actions, démarche dite d’écoresponsabilité déclinée dans certains festivals musicaux. On incite alors les usagers au covoiturage, on leur demande de trier leurs déchets sur les sites, de consommer nourriture et boissons bio produites localement, d’utiliser des écocups, des toilettes sèches, etc. D’autre part, tenter de limiter l’impact de la production musicale et en se concentrant en particulier sur (la mesure et la réduction) de l’impact carbone.
Dans cet article, je m’intéresse principalement à la troisième approche, que l’on pourrait qualifier d’aménagiste, qui se propose de rendre soutenable la production musicale sans en modifier fondamentalement la structure et le fonctionnement.
Les limites de l’engagement individuel
Dans les mondes de la musique, et en tout premier lieu dans les (festivals de) musiques populaires, l’accent a d’abord été mis sur l’engagement — limité — des spectateur·ices sans trop prêter attention à la production musicale. Or, se concentrer sur la responsabilisation et l’action des consommateur·ices n’est pas suffisant. Relayant une étude du cabinet Carbone 4, un article du journal Reporterre montre, qu’en matière d’émissions de gaz à effets de serre, la seule action des individus ne peut suffire[13]. D’abord, car une partie des individus (en particulier les privilégiés) refuse de s’engager et, ensuite, car même si un nombre considérable des personnes réduisait le chauffage, privilégiait les transports en commun, limitait sa consommation de viande, etc. le compte n’y serait pas. Pour réduire véritablement les émissions de Co2, il faut que les activités de production se transforment profondément et que l’usage des énergies fossiles soit interrompu sans délai. Tant que les pratiques prédatrices de l’industrie (y compris de la musique), des Gafam, de l’agriculture et de la pêche intensives, du BTP, des compagnies pétrolières et gazières, des chaînes logistiques[14] et les activités d’extraction[15], seront maintenues, rien ne sera possible. Et Reporterre de noter que de telles métamorphoses ne pourront se dérouler sans que des lois, des réglementations, des traités ne les contraignent et les contrôlent. Pour confirmer encore un peu plus ce point, prenons un autre exemple[16]. D’après l’agence pour la transition écologique (Ademe)[17], la France produit 868 millions de tonnes de déchets par an : 41 % du BTP, 41 % par l’agriculture et la pêche, et 4 % par les particuliers (le reste n’est pas identifié). Si les déchets des usagers ont tendance à baisser, ceux liés à la production ne cessent d’augmenter ! De plus, et comme l’ont montré les récents travaux de Baptiste Monsaingeon, le recyclage des déchets domestiques, géré par des transnationales comme Veolia, est peu efficient[18]. Il est par exemple impossible de recycler de nombreux types de plastiques et ceux qui l’ont été une fois se dégradent très lentement. De même, la baisse des déchets dans les métropoles des pays riches est souvent liée à leur exportation dans d’autres pays et en particulier dans des régions pauvres[19]. On vide à un endroit pour remplir (et polluer) à un autre. Pour réduire drastiquement les déchets (agricoles, chimiques, domestiques, etc.), il faut en fait arrêter d’en produire. Faute de quoi, ceux-ci continueront de polluer les sols, les cours d’eau, de s’immiscer dans les organismes et de détruire les écosystèmes et la santé des humains. Dans la musique comme ailleurs, l’écoresponsabilité à destination des publics est donc peu efficiente et ne permet pas d’engager une véritable transformation. C’est une écologie de surface qui néglige la part, pourtant déterminante, de la production.
La dimension matérielle des pratiques musicales
Prenant acte des maigres résultats liés à l’écoresponsabilité et compte tenu de la centralité de plus en plus affirmée des questions écologiques, le monde de la musique, en particulier pour ce qui concerne le live, a sensiblement évolué ces dernières années.
Créé en 2019 dans l’espace anglophone, Music Declares Emergency (MDE) fédère des labels de disques, y compris des majors, des groupes et des artistes de musiques populaires, dont certains à la notoriété mondiale, des structures de production, de diffusion, de gestion, de management, des studios, des festivals, des écoles, des réseaux professionnels, en bref toutes les composantes de ce que l’on désigne en anglais par music industry [20]. Lié à l’ONG britannique Julie’s Bicycle, qui entend mobiliser le monde artistique pour faire face aux défis écologiques, et affichant sa sympathie pour des activistes comme Extinction Rebellion[21] ou Greta Thunberg, l’objectif principal de MDE est de s’attaquer à l’empreinte carbone de son secteur. Autrement dit, MDE prend acte de la contribution l’industrie musicale aux effondrements écologiques. C’est ainsi que le groupe Coldplay a durant un temps cessé ses tournées ou que la formation (de trip hop) Massive Attack a commandé au Centre Tyndall de l’Université de Manchester, une étude sur l’impact carbone de ses tournées. Le rapport, produit par cet organisme de référence en matière de recherche environnementale, est désormais disponible en ligne. Il liste les différents facteurs d’émission carbone et propose une série d’améliorations possibles, tant du côté de l’activité du groupe que des salles et festivals qui accueillent ses tournées[22].
En France, des personnes travaillant au sein de structures de production et de lieux de spectacles et de musique (y compris non électrifiée) ont créé en 2020 l’association Arviva. Son objectif est de transformer fortement et sans délai les pratiques dans (tous) les arts de la scène, musique comprise. Fondée par des femmes, dont la plupart sont impliquées dans la gestion et la production[23], l’association revendique également son féminisme et veille à la parité[24] .
Fin 2021, le Shift Project a publié un rapport intitulé Décarbonons la Culture, une série de recommandations qui prennent place dans un plan général de transformation de l’économie française proposée par ce think-tank [25]. Ce rapport bien documenté, et qui a reçu un fort écho dans les milieux professionnels, s’intéresse en particulier aux conditions de production des spectacles et à leurs circulations, postes les plus émetteurs en gaz à effets de serre. Il préconise notamment de réduire, rationaliser, mutualiser et rendre plus soutenable l’activité artistique et d’engager immédiatement une réduction des émissions carbone, en particulier en matière de tournées.
En écho à ces différentes initiatives, la Fedelima [26] a organisé, en avril 2022, une manifestation intitulée « Écologie et musiques actuelles »[27]. Si des ateliers étaient consacrés à toutes sortes de sujets, le sous-titre de la manifestation s’intitulait « agissons collectivement pour des tournées écoresponsables ».
D’une façon générale, la multiplication des initiatives professionnelles et institutionnelles, tellement nombreuses qu’il est impossible de les répertorier ici, atteste que quelque chose est en train de se passer : la dimension matérielle de la musique, et en particulier pour ce qui concerne les tournées, est désormais prise au sérieux. Dans ces différentes initiatives, ce sont les émissions de carbone et les tournées qui polarisent principalement l’attention. La transformation écologique est donc souvent envisagée par le biais de la transition énergétique[28].
L’essor des indicateurs
Comment propose-t-on généralement de mettre en œuvre cette décarbonation des tournées ? Lors des nombreuses rencontres professionnelles auxquelles j’ai assisté depuis plusieurs années, comme dans le rapport du Shift Project, la décarbonation est associée à une démarche de rationalisation des activités. Les structures doivent ainsi s’orienter de façon systématique et volontariste vers la sobriété énergétique (supprimer les usages superflus, réduire les déplacements, mutualiser les pratiques chaque fois que c’est possible, etc.). On recommande également de remplacer les technologies énergivores au profit d’autres plus sobres, par exemple renoncer aux anciens projecteurs, très gourmands en électricité, pour adopter des ampoules LED, etc. Ces options s’accompagnent fréquemment d’une défense des petites et moyennes organisations et d’une critique (parfois très vive) du gigantisme des très grands événements et/ou des structures transnationales. Je reviendrai sur ce point plus loin.
Comment alors apprécier et réduire les émissions ? Grâce à des indicateurs. Communément, ce sont des structures (ou des personnes) expertes en environnement qui fournissent aux équipes artistiques, aux lieux de diffusion, aux producteurs de spectacles, aux associations, aux (regroupements de) festivals, aux divers réseaux, des méthodes pour établir des bilans et des outils pour transformer les pratiques. Dans ce cadre, on recourt fréquemment à des outils et réseaux informatiques. Au printemps 2022, le Centre National de la Musique — organisme public qui soutient le secteur professionnel en France — a attribué des subventions et des prix à des structures innovantes [29]. Une des structures récompensées proposait précisément de fournir à des organisateurs de spectacles des outils numériques connectés capables de mesurer différents impacts et en particulier les émissions carbone[30]. Comme c’est souvent le cas dans le monde des musiques actuelles, la structure indiquait que la mise au point des indicateurs s’effectuerait dans le cadre d’un processus collaboratif.
Cette vogue des indicateurs et des mesures s’inscrit dans des dynamiques anciennes. En corrélation avec l’essor de la Révolution Scientifique, le « gouvernement par les nombres » a débuté dans l’Europe du 18e siècle, lorsque les statistiques ont commencé à être utilisées par les états (puis les compagnies privées) afin de mesurer certains phénomènes, par exemple la mortalité, et ajuster leur action, Au 19e siècle, l’essor des bureaucraties étatiques — notamment françaises et allemandes — va de pair avec un recours de plus en plus accru aux nombres[31]. Bien sûr, utiliser des chiffres, des fractions, des pourcentages, des indicateurs pour figurer des êtres vivants, des choses, des collectifs, des territoires et en déduire des politiques est tout sauf neutre. Au cœur de cette philosophie réside la conviction que l’on peut (et doit) quantifier le monde pour le maîtriser. Les politiques néolibérales, dont on peut dater le début aux années 1970, ont accentué et systématisé ce gouvernement par les nombres. Dans les politiques publiques en matière d’environnement, on utilise de plus en plus des chiffres pour sensibiliser les individus. Vous achetez un ticket de train ? La SNCF vous indique le coût carbone de votre voyage sur le billet. Vous voulez comprendre l’impact des vidéos en streaming, de l’envoi d’un email, d’une visioconférence ? L’Ademe vous indique votre empreinte carbone en kilogrammes sur un site web[32] et sur son site Datagir, elle propose des simulateurs capables de calculer l’impact des individus en matière de déchets, d’alimentation, de transports et de logement[33].
Or, la production de données de ce type résulte souvent de partis-pris discutables voire d’occultations[34]. Lorsque l’on examine comment des secteurs industriels ou des états établissent des données sur leur engagement écologique, on tombe souvent des nues[35]. L’association NégaWatt, qui élabore des scénarios de transition énergétique pour arriver à l’élimination des énergies fossiles, a montré que nombre de calculs et de rapports émanant d’organismes publics ou d’entreprises privées ne comptabilisent pas correctement les émissions de carbone, omettant de prendre en compte certains paramètres[36]. NégaWatt montre qu’il est capital de considérer « les émissions importées, c’est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre engendrées par la fabrication à l’étranger de biens importés en France » et “les évolutions possibles de consommation et de production de matériaux (acier, béton, cuivre, plastiques, lithium, etc.)”[37]. En résumé, pour chiffrer au mieux une émission, il faut inclure toutes ses composantes et, autre point axial, que la façon dont les données ont été produites soit explicitée.
En régime néolibéral, la numérisation généralisée se traduit également par le fait de convertir les activités humaines et les écosystèmes en équivalent monnaie. Chaque composante d’un système se voit ainsi assigner une valeur monétaire et va ensuite prendre place dans une équation financière. Dans les hôpitaux publics, on a ainsi doté chaque acte, chaque objet d’un coût. Pour réaliser des économies budgétaires, les managers ont alors limité le plus possible les dépenses de fonctionnement et de personnel ainsi que le temps de séjour. Cette politique a mis à genou le système de santé publique et a engendré un armada bureaucratique qui harcèle les soignant·es et chosifie les patient·es[38]. Au point de vue environnemental, cette démarche a aussi ses partisans et se traduit dans notamment dans les politiques publiques. Des marchés carbone, où les états, villes où les entreprises de la communauté européenne échangent leurs émissions, ont ainsi été créés dès 2005. Si un opérateur n’utilise pas son quota d’émissions, il peut alors le vendre à des opérateurs qui, eux, l’ont dépassé[39]. Ces derniers ont donc la possibilité d’acheter (le mot usuel est « compensé ») leurs pollutions. De même, il est possible de financer des actions avec des ONG afin de compenser ses émissions[40]. En matière de transports, on se rappelle aussi que le gouvernement français avait créé en 2018 une écotaxe sur les carburants fossiles, afin d’inciter les automobilistes à limiter l’usage de la voiture individuelle.
Avec ces exemples, on retrouve deux idées. Premièrement, augmenter le coût d’une pratique encourage(rait) tous les acteurs à adopter de bonnes pratiques et, deuxièmement et conséquemment, le marché serait un bon régulateur. Dans la réalité, les choses sont moins enchantées. Pourquoi ? Et bien parce que les fameux « agents économiques rationnels » de l’économie classique appartiennent à des classes sociales ou à des pays plus ou moins pauvres ou riches. Tandis que les Gilets Jaunes se sont émus (à raison) que l’on taxe le carburant dans des zones sans transports en commun, sans services publics et sans commerces de proximité, certain·es habitant·es aisé·es des centres-villes continuent de parader (sans complexes) dans des SUV (peu taxés)[41]. De fait, l’augmentation du prix des carburants n’a pas beaucoup d’impact sur leurs pratiques. De la même manière, les pays riches achètent aux pays peu émetteurs (pauvres) des droits à polluer. Résultat, les premiers continuent à polluer tandis que les seconds subissent de plus en plus les conséquences de pratiques dont ils ne sont pas (ou peu) responsables.
Par ailleurs, la monétisation ne permet pas non plus d’apprécier la contribution réelle des choses et des êtres. Attribuer une valeur monétaire à un territoire, une forêt, aux « services » rendus par des écosystèmes, revient à négliger des interactions, des acteurs, des entités, des alliances essentielles. Si vous évaluez la qualité d’une forêt à l’aune du bois de chauffage qui peut être coupé chaque année ou encore au nombre de Co2 qu’elle absorbe, vous négligez tout ce qui ne peut pas être quantifié [42]. Vous oubliez les bactéries et les micro-organismes qui transmettent des informations aux arbres et contribuent à la régénération des sols[43]. Vous passez sous silence la façon dont les différents écosystèmes de la forêt participent à la biodiversité. Vous omettez également de prendre en compte le plaisir des personnes qui s’y promènent et la contribution de la forêt à la culture locale. La monétisation ne fait donc pas qu’instrumentaliser les choses (forêt = masse du bois coupé chaque année), elle empêche d’appréhender tous les apports, la complexité et la richesse des écosystèmes[44].
On voit donc les limites et les biais des approches quantifiées et/ou financiarisées des émissions carbone et, plus généralement, des questions environnementales. Si la monétisation peut être d’une certaine utilité, par exemple pour estimer les dommages (marées noires, pollutions chimiques) que des transnationales et/ou des états ont causés à des sites et à des populations et leur verser des dédommagements, systématiser cette approche atrophie la perception des problèmes et des enjeux socio-environnementaux [45]. De même, si la quantification des pollutions/émissions est souvent nécessaire, elle doit s’inscrire dans une démarche systémique considérant toutes les dégradations environnementales et sociales et leurs interactions.
Les technologies peuvent-elles nous sauver ?
Intéressons-nous à présent aux outils numériques et aux nouvelles technologies. Celles-ci peuvent-elles nous aider à réduire drastiquement les consommations grâce à une plus grande efficience et réorienter radicalement les activités ? Pas sûr…
En matière d’énergie, la première objection a été énoncée dès le 19e siècle par l’économiste britannique William Stanley Jevons (1835-1882) et s’intitule l’effet rebond[46]. Dans un régime basé sur le profit et l’expansion, l’optimisation d’une technologie est plutôt utilisée par les acteurs économiques afin d’augmenter leur capacité de production et leurs marges. Ainsi, rien ne dit que la généralisation des projecteurs de spectacles à LED sera mécaniquement synonyme d’économies d’électricité. Nombre de ces appareils étant motorisés et pilotés avec des outils numériques (convertisseurs, logiciels, consoles, mises à jour sur le Web, etc.), il est probable que l’économie réalisée avec les ampoules sera anéantie par les autres fonctions et systèmes associés au projecteur. Sans doute aussi que l’économie réalisée amènera les salles et les festivals à agrandir leur parc de projecteurs ou à investir dans d’autres activités [47].
Deuxièmement, il est rare qu’une technologie soit remplacée par une autre. La règle est plutôt l’accumulation et la coexistence, un point clairement illustré dans les travaux d’Edgerton sur l’histoire des technologies et plus récemment dans ceux de Fressoz sur la « transition énergétique » [48]. De fait, le pétrole n’a pas remplacé le charbon qui n’a pas remplacé le bois, les énergies renouvelables n’ont pas détrôné les énergies fossiles (on verra pourquoi un peu plus loin). De même, à l’exception notable du télégraphe, aucune technologie de communication n’a vraiment disparu depuis la fin du 19e siècle : la télévision n’a pas remplacé la radio, la vidéo à domicile n’a pas remplacé le cinéma, les emails n’ont pas remplacé le téléphone, le Web n’a pas supprimé les médias antérieurs – même les cassettes audio ont survécu ! Toutes ces technologies se sont hybridées et on a assisté à une hausse et une diversification considérable des usages[49] et… des consommations énergétiques[50].
La troisième raison pour laquelle les indicateurs et les technologies numériques ne peuvent probablement pas contribuer positivement à la transformation écologique tient à la toxicité de ces outils et des infrastructures qui les soutiennent[51]. En effet, les outils numériques (personnels ou professionnels) sont extrêmement polluants. Leurs composants électroniques contiennent des métaux dont l’extraction, la transformation, la fabrication puis la mise au rebut sont extrêmement toxiques. Cette toxicité s’apprécie aussi à l’aune des millions de kilomètres de câbles, de terminaux, de data centers qui permettent à ces systèmes de fonctionner. À chaque étape de la vie de ces équipements, le travail précaire, notamment celui des enfants, et la violence à l’encontre des salarié·es sont monnaie courante[52]. Par ailleurs, la connexion croissante des personnes, des organisations et des objets au Web et la digitalisation de toutes les activités contribuent également à une forte hausse de la consommation électrique, le plus souvent tributaire d’énergies fossiles. Cette dépendance entre électricité et numérisation est bien documentée[53]. L’essor des infrastructures du web nécessite en effet une hausse de la production d’électricité et une extension des réseaux de distribution. Pour garantir leur bonne marche, les opérateurs électriques doivent alors se doter de nouvelles installations numériques (bâtiments, outils logiciels, lieux de stockage, personnels, etc.). Et bien évidemment, ces dispositifs nécessitent, à leur tour, d’être alimentés en électricité, d’ouvrir de nouveaux data centers, d’augmenter la puissance disponible, etc. [54] Recourir à des outils numériques (indicateurs, logiciels, hardware, connexion au web, utilisation de clouds, etc.) participe à l’extension sans fin du web et de la digitalisation et conséquemment de la consommation électrique. Les smart grid, smart cities, c’est-à-dire les systèmes informatiques censés gérer de façon plus intelligente l’électricité, ne peuvent donc pas tenir leurs promesses ! Fanny Lopez montre bien que c’est la connexion des énergies renouvelables aux grands réseaux électriques qui empêche de faire des économies d’énergie et de favoriser l’abandon des énergies fossiles. On a juste ajouté une nouvelle source d’électricité dans un système conçu pour produire toujours plus. Un système basé principalement sur la puissance et la connectivité[55], qui plus est administré par des sociétés privées, a peu de chances de s’autolimiter et encore plus de décroitre. Pour que l’électricité renouvelable contribue véritablement à l’abandon des énergies fossiles et à la baisse de la consommation énergétique, il faudrait la débrancher — au moins partiellement — des grands réseaux et relocaliser sa production et sa distribution[56]. Il faudrait alors que les politiques publiques favorisent plus d’autonomie et la mise en place de micro-réseaux.
En résumé, et comme le suggérait déjà l’effet rebond : une technologie ne peut pas être économe lorsqu’elle est connectée à un méga réseau dépensier. Pour reprendre l’expression de José Halloy, Nicolas Nova et Alexandre Monnin, ce n’est pas en utilisant des technologies zombies[57], dont l’impact est mortifère, que l’on préservera les écosystèmes et les sociétés. La bonne direction est plus probablement du côté des low tech, de l’entretien et de la réparation des systèmes existants et du démontage des méga-infrastructures [58]. Mesurer et tenter de réduire son empreinte carbone dans un océan de Co2 est vain. C’est l’entièreté du système qui doit être décarboné, dépollué par le bas, bien sûr, mais aussi — et simultanément — par le haut.
Et le périmètre ?
Un autre point faible des approches technicistes consiste en ce que leur « périmètre d’efficience » n’est souvent pas clairement défini. Lors de réunions consacrées aux enjeux écologiques dans les milieux professionnels de la musique, je suis frappé par le fait que l’on discute beaucoup de « solutions », de nouvelles façons d’agir (par exemple une compagnie qui renonce aux tournées ou à l’avion ou du passage au LED pour les éclairages scéniques) et d’impératifs (être sobre) mais sans jamais préciser le périmètre exact de ces actions et les dispositifs qui garantiraient leur réussite. Soudain les indicateurs disparaissent ! Dès lors que des conduites vertueuses (je reprends le vocabulaire usuel) ne sont menées que par une partie d’un milieu professionnel, elles n’ont pourtant aucune chance d’être efficaces et le greenwashing n’est alors plus très loin. Un exemple — issu d’une de mes recherches de terrain — illustre ce point. À la fin des années 1970, un collectif berlinois s’est installé dans une série de bâtiments jadis utilisés par la UFA, la grande firme cinématographique allemande[59]. Ce vaste espace est devenu une sorte de petit quartier de spectacles et d’activités artistiques[60] : la Ufa Fabrik. On y trouve des salles dédiées au théâtre, à la musique, à la danse, un open air pour des concerts l’été, un cinéma mais aussi des espaces où se déroulent des ateliers avec/pour des amateurs, un restaurant, une épicerie bio, des jardins… Toute l’année, de nombreux spectacles de toutes sortes y sont présentés. Dès sa naissance, le collectif a tenté d’être le plus écologique possible. Pendant près de 40 années, et grâce notamment à la mobilisation d’un des membres du collectif, percussionniste amateur et ingénieur, diverses installations ont été élaborées, testées, discutées et réajustées. Des systèmes de récupération d’eau sont utilisés pour les toilettes et des toits sont végétalisés et équipés de panneaux solaires. Des aménagements assurent un système d’air conditionné l’été (Berlin est suffocant durant cette période). La majeure partie du temps, la Ufa Fabrik produit sa propre électricité, renouvelable, et n’utilise le réseau extérieur que lorsque sa propre production est insuffisante. Une installation végétalisée protège les habitants du quartier des décibels lors des concerts en extérieur l’été. Une grande partie des déchets est recyclée, etc. Ce vaste savoir-faire a été soutenu financièrement par des institutions publiques, notamment la Communauté Européenne, et il a régulièrement inspiré des festivals, des lieux de production artistique et même dans d’autres sphères. Toutefois, quel que soit son rayonnement local, régional, national et international, et même si ses certaines de ses installations ont été répliquées ailleurs, la méthode Ufa Fabrik ne s’est pas généralisée. Les très nombreuses compagnies, groupes et artistes qui s’y produisent continuent à se déplacer et tournent dans des lieux « classiques » où l’on dilapide les ressources et l’énergie, où l’on produit des masses de déchets, utilise des technologies et des matériaux polluants, etc. Dans ce monde du off allemand -c’est-à-dire les professionnel·les du spectacle ne bénéficiant pas ou peu de subventions publiques — la précarité est également sensible et la concurrence fait rage. On l’aura compris, pour que les low tech de la Ufa Fabrik fassent florès, il faudrait que les politiques publiques accompagnent tous les lieux de spectacle et les équipes artistiques allemands, qu’on établisse des cadres réglementaires et que cette mutation résulte d’un débat démocratique. Il faudrait également que la concurrence effrénée entre les équipes artistiques, techniques et les salles de spectacle, qui favorise le moins-disant environnemental et l’exploitation des plus faibles, cesse. Sans des leviers de ce type, la magnifique expérimentation de la Ufa Fabrik reste(ra) isolée. On retrouve ici la raison pour laquelle les politiques de développement durable ont échoué : en agissant seulement à la marge d’un grand système et sans contraintes sur les agents économiques, la dynamique de transformation est faible. Ce qui est vrai à la Ufa l’est également dans d’autres sphères sociales. Après des années d’innovations sociales et techniques, de luttes et de débats, force est de constater que l’effet de balancier n’a pas eu lieu : les actions dans certains territoires (AMAP[61], productions bio à échelle locale et agroécologique, etc.) peinent à trouver leur traduction à une plus grande échelle. Cet échec à renverser la vapeur à l’échelle nationale est également patent au point de vue international. Les transnationales contournent les frontières et les réglementations accentuant encore un peu plus la destruction des milieux et la précarité sociale, les traités de libre-échange intensifient ces désastres tandis que les conférences pour le climat et la biodiversité patinent. L’inertie des gouvernements et des organisations internationales, l’activisme des lobbies, le poids déterminant des appareils de production et des infrastructures (énergétiques et en ressources, transports, communication) permettent certainement de comprendre pourquoi les diverses contre-cultures environnementales ont (eu) de fortes difficultés à s’imposer.
Les filets du néolibéralisme
On le voit avec la Ufa Fabrik, les États délèguent aux acteurs économiques la capacité d’agir sur le plan écologique sur la base de leur autonomie, ce qui limite les possibilités de changement systémique. Cette politique trouve sa source dans la tradition libérale, telle qu’elle émerge au XVIIIe siècle et que l’analyse Michel Foucault dans Naissance de la biopolitique : « Une technologie de gouvernement ayant pour objectif sa propre autolimitation dans la mesure même où elle est indexée à la spécificité des processus économiques »[62] Dans une telle acception, l’État ne doit pas entraver la créativité des activités économiques et les entrepreneurs ou les régenter, mais plutôt mobiliser ses moyens et son autorité afin de les soutenir. Dans le credo néolibéral, dont l’essor date de la fin des années 1970, l’état doit laisser au maximum le marché et la société civile prendre en charge tout ce qui est possible. L’excès de lois bride la société, trop de régulation étouffe l’initiative. Créatifs, souples, capables de s’adapter, les entrepreneurs et les entreprises font toujours mieux. Dans ce cadre, « L’analyse coûts/bénéfices [est] définie comme un nouveau critère de décision, une règle cardinale posée comme condition absolue pour tout projet de régulation »[63] Ainsi, afin de préserver les entrepreneurs, on va par exemple plutôt légiférer pour limiter la pollution que l’interdire. De ce fait, la régulation néolibérale procède exactement à l’inverse de l’économie écologique (ecological economics) qui prend non seulement en compte toutes les externalités négatives d’un produit ou d’une activité — évoquées plus haut — mais aussi les discriminations et les exploitations sociales [64]. Car, dans la plupart des productions, des fabrications, des transports, des traitements de déchets, des humains sont aussi maltraités que les milieux[65]. Peut-on parler de la marée noire provoquée par l’Amoco Cadiz en Bretagne (1978) ou de la catastrophe chimique de Bhopal en Inde (1984) sans prendre en compte les dommages causés aux communautés humaines ? Se focaliser exclusivement sur l’empreinte carbone d’un smartphone, c’est négliger la mine où des enfants extraient des métaux pour fabriquer ses circuits intégrés, la déforestation du terrain où se trouve la mine, la corruption (et les milices) que les transnationales utilisent pour se garantir l’accès aux ressources, les conditions de travail déplorables de ceux et celles qui travaillent sur les chaînes de fabrication du smartphone ainsi que les pollutions qui affectent les populations qui résident près des décharges électroniques où finissent les téléphones. Et ce qui est vrai pour un smartphone l’est également pour une console de mixage ou un projecteur de scène[66]. Jane Hutton a montré comment des aménagements urbains réalisés dans des pays riches — par exemple, l’usage du guano[67] dans les plates-bandes de Central Park à New York ou l’emploi de granit pour les chaussées de Broadway — ont été mis en place grâce à l’extraction non raisonnée des ressources naturelles et l’exploitation extrême de travailleurs dans des territoires assez éloignés. Comme l’indique le titre de son ouvrage Reciprocal Landscapes : Stories of Material Movements, à un territoire aménagé au nord correspond un territoire au sud dont les écosystèmes, les économies locales et les corps des travailleurs/euses sont profondément endommagés[68]. Au lieu d’internaliser les externalités négatives dans le coût des biens, les néolibéraux abordent les questions environnementales selon le point de vue des pollueurs : on internalise l’économie toxique dans l’environnement et les êtres vivants et on se polarise sur un ou deux facteurs.
Je l’ai dit plus haut, les néolibéraux considèrent que les entrepreneurs doivent eux-mêmes décider des réponses à donner à un problème. Pour ce faire, les organisations fédérant les entreprises d’un secteur organisent des conférences des parties prenantes (stakeholders) où l’on analyse la situation et où l’on fixe des objectifs. Puis, l’État annonce qu’il soutiendra financièrement les entrepreneurs et les prestataires spécialisés à engager ces transformations. Aidées par les prestataires, les entreprises qui le souhaitent se dotent alors d’appareils de mesure et de technologies adéquates. L’acquisition de ces dernières étant moins onéreuse pour les grosses entreprises que pour les petites, celles-ci ont plus de mal à s’équiper et à s’engager. Deux années plus tard, une nouvelle concertation fait le bilan global des actions, grâce au bilan chiffré fourni par les entreprises, et l’on négocie de nouveaux objectifs (sans réelles contraintes). C’est aussi selon ce modèle que fonctionnent les COP pour le climat. Si l’on prend l’exemple de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) dont la composante environnementale est devenue très conséquente, on constate pourtant que l’autorégulation ne fonctionne pas : « Ainsi, en soixante-dix ans d’existence et plus de vingt années d’intégration systématique aux organigrammes des grandes entreprises, la RSE est en grande partie l’histoire d’un échec : échec à infléchir la courbe des émissions de CO2, échec à stopper l’érosion vertigineuse de la biodiversité, échec à combattre le creusement continu des inégalités de richesse, et même échec à mettre un terme aux atteintes à la dignité humaine la plus élémentaire (les situations d’esclavage ou de travail forcé éclaboussent encore régulièrement les multinationales) »[69]. La RSE est la parfaite illustration de la privatisation par les entreprises et les organisations des politiques publiques[70]. Elle permet non seulement d’imposer la logique entrepreneuriale mais aussi de (tenter de) verdir l’image des firmes. En fait, la RSE est l’instrument par lequel les entreprises dessaisissent les politiques publiques et les populations de leur pouvoir d’agir, elle érige le conflit d’intérêts en norme. En fait, au moment où la RSE a été adoptée, nombre de grandes entreprises, par exemple dans le secteur pétrolier ou chimique, connaissaient parfaitement la toxicité de leurs activités pour les écosystèmes et les sociétés[71].
L’écologie managériale n’a pas été (et ne sera pas) capable de rendre durable le développement, elle contribue à la profonde détérioration du système Terre et des sociétés humaines. La défense de la libre entreprise et l’insistance sur la responsabilité des individus masquent les inégalités.
Or, ce sont très exactement ces façons de faire et cette philosophie, excluant quasi systématiquement les usagers et les ONG environnementales, qui sont déclinées par le secteur culturel subventionné en France. Les discours, les méthodologies, la répartition des rôles entre État, structures et experts-conseils et les objectifs sont identiques. Au moment où je rédige ces lignes, le SYNDEAC[72] publie un rapport où il décrit comment il va engager sa mutation écologique et prescrit des mesures à l’état[73]. Voilà donc un secteur fortement financé par des fonds publics qui décide lui-même comment il s’engage — après des années d’indifférence — dans la transition écologique. Lors d’un débat aux Biennales Internationales du Spectacles (BIS) auquel j’ai participé en janvier 2023, le responsable de ce syndicat n’a cessé d’affirmer que l’état, trop peu au fait des spécificités du secteur et bureaucratique, devait laisser les syndicats, les structures et les artistes conduire eux-mêmes leur transition[74]. Dans un même ordre d’idées, l’ouvrage de Jean-Claude Herry L’organisation d’événements engagés et responsables (édité par le CNM) présente la RSE comme la méthode à décliner dans le monde du spectacle[75].
On m’objectera sans doute que le secteur culturel recevant des subventions publiques, ne peut être assimilé au marché ou à l’industrie et que ses composantes, souvent de type associatives, ne sont pas des entreprises ordinaires. Outre le fait que les politiques néolibérales distribuent (aussi et abondamment) des subventions et des exemptions de cotisations sociales à tous les secteurs économiques, on ne voit pas en quoi la façon de mener la transformation écologique dans les milieux culturels diffère. En somme, ce secteur qui vante régulièrement l’économie sociale et solidaire et se présente comme un rempart contre les transnationales culturelles, s’engage exactement dans le même chemin que celui prôné par la doxa néolibérale. Qui plus est, il le fait très tardivement.
Pour faire face aux défis socio-environnementaux, il faudrait procéder d’une façon écologique, c’est-à-dire analyser de façon systémique les interactions qui se déroulent au sein d’un système (écosystème !) et prendre en compte et écouter tous les acteurs/trices et entités impliqué.es. (cf. l’exemple des Gilets Jaunes). Par ailleurs, un écosystème n’est pas un système clos que l’on pourrait réguler de l’intérieur. Cette conception très répandue dans les milieux professionnels, sorte de cybernétique fruste, a pourtant été abandonnée dès les années 1950 par nombre d’écologues[76]. En considérant les mondes musicaux comme des entités autonomes, on néglige d’abord leurs interactions avec d’autres milieux. On omet ensuite que, quelle que soit sa stabilité apparente, tout milieu est sans cesse soumis à des pressions extérieures, à des évolutions internes, qu’il s’adapte et se renouvelle continûment. Cette approche connectée est d’ailleurs de plus en plus présente dans les sciences. Renonçant à des disciplines en silo, les sciences (et le concept) du système Terre appréhendent les différentes constituantes de la planète, leurs interactions et les activités humaines comme un tout[77]. On peut également remarquer que, depuis 2013, l’ONU a soutenu la création de la Plateforme Intergouvernementale Scientifique et Politique sur la Biodiversité et les Services Écosystémiques (IPBES), souvent appelée le GIEC de la biodiversité[78]. Là encore, on a compris que la lutte contre le réchauffement climatique ne pouvait suffire.
[1] www.sudouest.fr/environnement/climat/hellfest-plus-de-800-malaises-causes-par-la-canicule-depuis-le-debut-de-l-edition-2022-11348353.php
www.midilibre.fr/2022/06/18/canicule-au-hellfest-450-prises-en-charge-par-les-secours-et-15-evacuations-pour-la-premiere-journee-du-festival-10374425.php
[2] www.telerama.fr/musique/jean-paul-roland-directeur-des-eurockeennes-les-aleas-climatiques-revelent-la-fragilite-des-festivals-7011196.php
www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2022/06/30/tempete-et-degats-enormes-comment-le-ciel-est-encore-tombe-sur-la-tete-du-festival
[3] www.theguardian.com/world/2022/aug/13/spanish-festival-stage-damaged-by-high-winds-killing-one-and-injuring-dozens-medusa
[4] www.liberation.fr/environnement/climat/un-incendie-virulent-a-deja-detruit-plus-de-700-hectares-en-quatre-heures-dans-le-vaucluse-20220714_C4USP3R3MBGHBLSJTOMAWQYPUM/
mobile.twitter.com/MeteoLanguedoc/status/1547642421797797890
[5] www.liberation.fr/environnement/climat/dereglement-climatique-en-europe-comment-2022-a-change-le-visage-de-nos-etes-20230420_E4G342KO35AILK565DPWCAVZ2E/
https://climate.copernicus.eu/esotc/2022/european-state-climate-2022-summary
[6] Carras, Christos, et Philippe Van Parijs. 2021. « The European Cultural Sector, Pandemic Precarity, and Universal Basic Income ». Open Democraty. https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/european-cultural-sector-pandemic-precarity-and-universal-basic-income/
Carras, Christos. 2020. « Getting our act together: in the European non-profit cultural sector ». Open Democraty. www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/getting-our-act-together-european-non-profit-cultural-sector/
[7] www.mediapart.fr/journal/international/291021/origines-du-covid-19-les-dernieres-revelations
www.lemonde.fr/sciences/article/2023/04/04/origine-du-covid-19-la-presence-de-chiens-viverrins-sur-le-marche-de-wuhan-confirmee_6168229_1650684.html
[8] Lin-Fa Wang et Christopher Cowled, (dir.) 2015. Bats and Viruses: A New Frontier of Emerging Infectious Diseases. Hoboken : John Wiley & Sons. Voir également Frédéric Keck « Anthropologie des microbes. L’oubli de l’immunologie et la révolution du microbiome ». Techniques & Culture » 2017/2 (68): 230-247 ; Frédéric Keck « Santé animale et santé globale ; la grippe aviaire ». Revue Tiers Monde 2013/3 (215): 35-52 ; Gil Bartholeyns. Le hantement du monde. Zoonoses et pathocène. Éditions Dehors, 2021.
[9] Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monnin. Héritage et fermeture. Une écologie du démantèlement. Divergences, 2021.
[10] www.legrandorchestredesanimaux.com/fr">https://www.legrandorchestredesanimaux.com/fr
Pour une critique de ces approches, voir François Ribac « Que peuvent (ou pas) les arts de la scène » in L’écologie en scène édité par Éliane Beaufils et Climène Perrin. Presses Universitaires de Vincennes. À paraître
en 2023.
[11] Pour Pedelty, un des pionniers de l’écomusicologie, l’impact environnemental du Live Earth, lié aux tournées et à la diffusion mondiale, est désastreux.
Mark Pedelty. Ecomusicology: Rock, Folk, and the Environment. Temple University Press, 2012.
[12] https://www.un.org/french/events/envifr2.htm
[13] Gaspard d’Allens, « Climat : l’action individuelle ne peut pas tout ». Reporterre. reporterre.net/Climat-l-action-individuelle-ne-peut-pas-tout
https://www.carbone4.com/
[14] Anna Lowenhaupt Tsing « Supply Chains and the Human Condition ». Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society 21 (2): 148‑176, 2009 ; Anna Lowenhaupt Tsing « What Is Emerging? Supply Chains and the Remaking of Asia ». The Professional Geographer. En ligne : 1‑8, 2016 ; Mathieu Quet. Flux. Comment la pensée logistique gouverne le monde. La Découverte, 2022 ; Fanny Lopez. À bout de flux. Divergences, 2022.
[15] Yves-Marie Abraham et David Murray (dir.) Creuser jusqu’où ? Extractivisme et limites à la croissance. Les Éditions Écosociété, 2015 ; Mathieu Brier et Naïké Desquesnes. Mauvaises mines. Les ami.e.s de Clark Kent/Agone, 2018
[16] François Jarrige, Thomas Leroux et Stéphane Le Lay. « Le rôle des déchets dans l’histoire ». Mouvements : 59–68, 2016.
[17] www.ademe.fr
[18] Baptiste Monsaingeon. Homo detritus. Critique de la société du déchet. Seuil, 2017.
[19] Natalie Benelli, Delphine Cortel, Octave Debarry, Bénédicte Florin, Stéphane Le Lay et Sophie Rétif. Que faire des restes ? : Le remploi dans les sociétés d’accumulation. Presses de Sciences Po, 2017.
[20] https://www.musicdeclares.net/fr/
[21] https://extinctionrebellion.fr/
[22] https://tyndall.ac.uk/news/massive-attack-publish-tyndall-centre-climate-change-live-music-roadmap/
[23] https://wp.arviva.org/lassociation/
[24] On a sans doute ici la vérification de ce que montrent les écoféministes : chargées de prendre soin des personnes et des choses, souvent cantonnées dans des fonctions moins prestigieuses que les hommes, les femmes appréhendent souvent avec une plus forte acuité les prédations environnementales et les autres types de dominations. Maria Mies et Vandana Shiva (dir.) Ecofeminism. Zed Books, 2014 ; Giovanna Di Chiro « Ramener l’écologie à la maison ». In De l’univers clos au monde infini, Émilie Hache (dir.) 191-220. Dehors, 2014 ; Émilie Hache (dir.) Reclaim. Recueil de textes écoféministes. Cambourakis, 2016.
[25] theshiftproject.org/article/decarboner-culture-rapport-2021/
[26] Fedelima : Fédération des lieux de musiques actuelles.
[27] www.fedelima.org/article482.html">https://www.fedelima.org/article482.html
[28] https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/05/le-spectacle-vivant-au-defi-de-la-sobriete-energetique_6148598_3246.html
[29] cnm.fr/le-cnm-a-remis-pour-la-premiere-fois-le-prix-de-linnovation-dans-la-musique-a-3-structures-innovantes/ On notera au passage que le CNM récompense dans un même temps des structures qui préparent le passage de la musique dans le métavers, un monde virtuel dans lequel Facebook investit massivement, et des projets censés favoriser la transition écologique.
[30] https://www.bma-impacts.org/
[31] Éric Brian. La mesure de l’État. Paris, 1994 ; Alain Desrosières. La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique. La Découverte, 2010. Voir également Donald A. Mackenzie qui montre la collusion entre statistique et eugénisme : Statistics in Britain 1865-1930. The Social Construction of Social Knowledge. Edinburgh University Press, 1981.
[32] Ademe = agence pour la transition écologique. https://longuevieauxobjets.gouv.fr/impact-co2-du-numerique
[33] https://datagir.ademe.fr/
[34] Lisa Gitelman. Raw Data Is an Oxymoron. The MIT Press, 2013
[35] www.mediapart.fr/journal/france/160722/le-beton-vert-arme-de-la-transition-ecologique-fait-chou-blanc
[36] negawatt.org/Scenario-negaWatt-2022 L’association a montré qu’il était possible d’atteindre la neutralité carbone en 2050 et avec 96 % d’énergies renouvelables.
[37] Idem
[38] Jean-Paul Gaudillière, Caroline Izambert et Pierre-André Juven. Pandémopolitique. Réinventer la santé en commun. La Découverte, 2021 : sur néolibéralisme et bureaucratie : David Graeber. Bureaucratie. Les liens qui libèrent, 2015.
[39] https://www.ecologie.gouv.fr/marches-du-carbone
[40] Une récente enquête menée par The Guardian and Die Zeit montre que la plupart de ces actions procèdent du greenwashing.
www.liberation.fr/environnement/climat/la-majorite-des-credits-carbone-ne-valent-rien-selon-une-enquete-20230121_GCCG75GKFFAUTALUU7SSLJWWUA/
[41] Brice Le Gall, Lou Traverse et Thibault Cizeau. Justice et respect : le soulèvement des Gilets jaunes. Syllepse, 2019 ; Laurent Jeanpierre. In Girum. Les leçons politiques des ronds-points. La Découverte, 2019 ; Valérie Deldrève « La fabrique des inégalités environnementales en France ». Revue de l’OFCE 1 (165), 2020.
[42] Ronald E Hester et Roy M. Harrison (dir.) Ecosystem Services. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2010.
[43] Peter Wohlleben. La vie secrète des arbres. Multi-Mondes, 2017.
[44] Là-dessus : Geneviève Azam, Christophe Bonneuil et Maxime Combes. La nature n’a pas de prix. Les méprises de l’économie verte. Les liens qui libèrent, 2012 ; Giorgos Kallis, Erik Gómez-Baggethun et Christos Zografos. « To value or not to value? That is not the question ». Ecological Economics 94, 2013 ; Jean Gadrey et Aurore Lalucq. Faut-il donner un prix à la nature ? Les petits matins, 2015.
[45] Kallis, Gómez-Baggethun et Zografos. Ibidem.
[46] William S. Jevons. The Coal Question: An Inquiry Concerning the Process of the Nation and the Probable Exhaustion of Our Coal Mines. Macmillan, 1865.
[47] Une récente étude montre qu’en matière d’éclairage public, les LED contribuent de façon significative à la pollution lumineuse. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abq7781
[48] David Edgerton. Quoi de neuf ? Du rôle des techniques dans l’histoire. Seuil, 2013 ; Jean-Baptiste Fressoz, « Pour une histoire des symbioses énergétiques et matérielles ». Annales des Mines -Responsabilité et environnement -1 (101) : 7-11, 2021.
[49] François Ribac, L’avaleur de rock, La Dispute, 2004.
[50] Voir le travail de Kyle devine et Matt Brennan sur l’impact du streaming. https://theconversation.com/music-streaming-has-a-far-worse-carbon-footprint-than-the-heyday-of-records-and-cds-new-findings-114944
[51] Fabrice Flipo, Michèle Dobré et Marion Michot. La face cachée du numérique. L’échappée, 2013 ; Adam Minter, Adam. Junkyard Planet. Bloomsberry Press, 2013 ; Sean Cubitt. Finite Media: Environmental Implications of Digital Technologies. Duke University Press, 2017 ; Mark J. P Wolf (dir;) The Routledge Companion to Media Technology and Obsolescence. Routledge, 2019.
[52] www.amnesty.org/fr/latest/news/2016/01/child-labour-behind-smart-phone-and-electric-car-batteries/
www.lemonde.fr/economie/article/2022/11/25/en-chine-des-emeutes-dans-la-principale-usine-d-iphone-du-monde-revelent-les-limites-du-zero-covid_6151563_3234.html
[53] Gérard Dubey et Pierre de Jouvancourt. Mauvais temps. Anthropocène et numérisation du monde. Éditions Dehors, 2018 ; Fanny Lopez. Infrastructures énergétiques et territoire. L’ordre électrique. Metis Presse, 2019. Voir également Gérard Dubey et Alain Gras. La Servitude électrique : Du rêve de liberté à la prison numérique. Seuil, 2021.
[54] Fanny Lopez et Cécile Diguet. « Data centers. Derrière la façade. Le coût réel des données virtuelles ». Revue du Crieur 2 (10), 2018.
[55] Thomas P. Hughes. Networks of Power. Electrification in Western Society 1880-1930. The Johns Hopkins University Press, 1983 ; Thomas P. Hughes « The Evolution of Large technological Systems ». In The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History of technology, Bijker, Hughes et Pinch, 45‑76. MIT Press, 2012.
[56] Idem
[57] José Halloy, Nicolas Nova et Alexandre Monnin. « Au-delà du low tech : technologies zombies, soutenabilité et inventions ». Passerelle n° 21 21 (Low tech : face au tout-numérique, se réapproprier les technologies), 2020.
[58] Philippe Bihouix. L’âge des low tech: Vers une civilisation techniquement soutenable. Seuil, 2014 ; Isabelle Berrebi Hoffmann, Isabelle, Marie-Christine Bureau et Michel Lallement. Makers. Enquête sur les laboratoires du changement social. Seuil, 2018.
[59] Hans-Michael Bock et Michael Töteberg (dir.) Das Ufa-Buch. Zweitausendeins, 1992 ; Klaus Kreimeier. Une histoire du cinéma allemand : la Ufa. Flammarion, 1994.
[60] https://www.ufafabrik.de/fr/14546/developpement-durable.html
[61] AMAP : Association pour le maintien d’une agriculture paysanne. Des consommateurs garantissent à un.e paysan.n.e qu’ils/elles achèteront ses produits pour une période donnée et, dans certains cas, donnent un coup de main. Réciproquement, la production doit être bio et respecter des normes.
[62] Michel Foucault. Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-79, Seuil/Gallimard, 2004, p. 300.
[63] Grégoire Chamayou. La société ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire, La Fabrique, 2018, p.170.
[64] Joan Martinez-Alier et Roldan Muradian (dir.) Handbook of Ecological Economics. Edward Elgar, p. 3, 2015. Voir aussi Juan Martinez-Alier. The Environmentalism of the Poor. A Study of Ecological Conflicts and Valuation. Edward Elgar Publishing Limited, 2002.
[65] Robert D Bullard. (dir.) Confronting Environmental Racism. South End Press, 1993 ; Rob Nixon. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Harvard University Press, 2011 ; Juan Martinez-Alier. The Environmentalism of the Poor. A Study of Ecological Conflicts and Valuation. Edward Elgar Publishing Limited, 2002 ; Dorceta E. Taylor. Toxic Communities. Environmental Racism, Industrial Pollution, and Residential Mobility. New York University Press, 2014.
[66] Eliot Bates « Resource ecologies, political economies and the ethics of audio technologies in the Anthropocene. » In Popular Music 39 (1) : 66-87.
[67] Le guano est issu de la décomposition d’excréments et de cadavres d’oiseaux. Il est très riche en azote.
[68] Jane Hutton. Reciprocal Landscapes: Stories of Material Movements. Routledge, 2020. Voir la traduction d’un des chapitres dans la revue Habitante.
[69] Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et Laure Teulières (dir.) Greenwashing. Manuel pour dépolluer le débat public, Seuil, 2022, p.145.
[70] Toby Miller, Greenwashing Culture. Routledge, 2018.
[71] Voir par exemple l’ouvrage de Nathaniel Rich, Second Nature. (Farrar, Straus and Giroux 2021) qui montre comment la firme chimique DuPont a déversé des produits toxiques dans des décharges alors que ses ingénieurs avaient documenté son extrême toxicité. Exemple adapté par Todd Haynes dans le film de 2019 Dark Waters. On se reportera également à des récents travaux qui montrent que dès les années 1970, les équipes de recherche de Total avaient identifié les liens entre usages des industries fossiles et réchauffement climatique : Christophe Bonneuil, Christophe, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta. 2021. « Early warnings and emerging accountability: Total’s responses to global warming, 1968-2021 ». Global Environmental Change. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378021001655
[72] Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles.
[73] https://www.syndeac.org/la-mutation-ecologique-dans-le-spectacle-vivant-28431/
[74] L’audio du débat : https://soundcloud.com/chez-dd/bis-2023-lexception-culturelle-est-elle-compatible-avec-la-transition-ecologique
[75] Jean-Claude Herry. 2022. L’organisation d’événements engagés et responsables. Paris, CNM éditions.
[76] John Baird Calicott, 1999. Beyond the Land Ethic: More Essays in Environmental Philosophy. New York, University of New York Press. Pages 5445–5705 (ebook).
[77] https://www.ipgp.fr/fr/systeme-terre Voir également James Lovelock; Gaïa. Oxford University Press, 2000.
[78] https://ipbes.net/fr